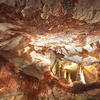Vous êtes ici
Le mystère des cristaux du gouffre d’Esparros

« De ma vie, je n’avais vu de telles merveilles, une telle floraison minérale d’une délicatesse et d’une pureté inimaginable. (…) Les parois sont tapissées, surchargées de myriades de houpettes, de pompons blancs qui forment le plus délicat et le plus somptueux décor que l’on puisse imaginer. » C’est en ces termes que le spéléologue Norbert Casteret décrit dans son livre, Ma vie souterraine (Flammarion, 1961), les concrétions du gouffre d’Esparros, découvert en 1938 avec son ami Germain Gattet. Près d’un siècle plus tard, une équipe pluridisciplinaire de chercheurs du CNRS et d’universitaires cherche à comprendre comment se sont formés ces trésors cristallins… pour mieux les protéger. C'est l'objectif de cette deuxième mission scientifique 2021, la première ayant eut lieu au printemps.
Des cristaux curieusement agencés
L’histoire commence en 1996, alors que le géologue François Bourges, directeur du bureau d’études Géologie Environnement Conseil à Saint-Girons et mordu des milieux souterrains, observe dans cette grotte des Hautes-Pyrénées un étrange phénomène : les sublimes cristaux d’aragonite que ses parois recèlent s’arrêtent net à une même altitude tout le long de la galerie. « François s’est posé des questions, a fait une manip et nous a dit ʺlà il y a un truc qui mérite réflexionʺ. C’est comme ça que tout s’est déclenché », raconte Bruno Lartiges, physico-chimiste de l’environnement à l’université de Toulouse, au laboratoire Géosciences Environnement Toulouse1 (GET) , qui chapeaute le projet scientifique à Esparros. À l’époque, François Bourges est chargé, avec la Station d'écologie théorique et expérimentale (Sete) de Moulis en Ariège, de mettre en place un suivi scientifique du gouffre au préalable de son aménagement. L’objectif est de concilier exploitation touristique et préservation des joyaux d’Esparros.

Trois hypothèses émergent alors pour expliquer la curieuse limite de cristallisation. Une transformation chimique où intervient une roche nommée dolomie ? Pas de dolomie, hypothèse invalidée. Un ancien niveau d’eau ? De l’aragonite a poussé sur des stalactites ayant elles-mêmes crû au-delà du niveau d’eau présumé… Invalidée. Penchant pour la 3e possibilité, une intervention de l’air, et sachant que certaines cristallisations nécessitent une évaporation, le chercheur installe en 2017 des capteurs de température à différentes hauteurs afin d’établir un profil vertical.
De mystérieuses masses d'air souterraines
En haut, il fait plus chaud qu’en bas, le passage d’une température à l’autre se faisant précisément… à la limite de l’aragonite. Eurêka ! aussi invisibles soient-elles, nous avons bien affaire à deux masses d’air. S’ensuit la réalisation d’un profil vertical de l’humidité à l’aide d’hygromètres et d’évaporomètres : l’air est saturé en hauteur mais pas sous l’énigmatique trait. Parfait pour une cristallisation. Reste que l’anémomètre ne détecte aucun courant d’air alors que thermodynamiquement parlant, la cohabitation stable, sans aucun mouvement, de deux masses d’air homogènes aux températures différentes n’est pas possible. Nouveau mystère.
C’est le début d’une longue épopée où, à mesure des avancées dans la compréhension, naîtront de nouveaux questionnements. Où, de fil en aiguille, se constituera une équipe de chercheurs des quatre coins de la France, aussi hétéroclite qu’unanimement passionnée, réunie à présent dans un groupement d’intérêt scientifique du CNRS, le Groupe d’études des milieux souterrains (Gems).
On sait maintenant qu’il y a bien une circulation des masses d’air identifiées, qu’elle fonctionne toujours au vu de la croissance en une décennie de nouveaux cristaux d’aragonite, et qu’elle est au bas mot âgée de 114 000 ans, selon la première datation d’une aiguille d’aragonite. Elle relève même d’un type non décrit jusqu’ici : une sorte de tapis roulant qui naît en bas par l’air plus frais et donc plus dense, et fait demi-tour au fond de la grotte, l’air réchauffé (moins dense) et humidifié passant côté voûte, pour repartir dans le sens inverse.
En témoignent les stalagmites en « brosse à dents », dont le manteau d’aragonite ne s’est tricoté que d’un côté. Le pendant de cette cristallisation aéro-médiée semble être une importante corrosion des parois en hauteur, favorisée par l’humidité et la chaleur.

De grandes questions restent cependant à éclaircir. D’où donc vient cet air ? A priori pas de l’entrée naturelle ni du réseau souterrain proche de Labastide qu’on suspecte d’être en communication avec celui d’Esparros. Comment caractériser précisément son mouvement si faible ? Comment se forment les différents types de cristaux d’aragonite, suivant quelle chronologie et à partir de quelle matière ? Une disparition brusque de l’eau circulant dans la galerie, par exemple du fait d’un puits d’effondrement, aurait-elle favorisé leur croissance ? La datation comparée des bourrelets de calcaire du lit de la rivière asséchée, les gours, et des cristaux d’aragonite pourrait apporter un élément de réponse. L’on s’interroge également sur l'origine du radon et des nouvelles masses d’air détectées à la précédente expédition en mars. Enfin, la recherche la plus inhabituelle est peut-être celle de l’intervention potentielle de micro-organismes – dont 70 % vivraient dans la croûte terrestre – dans la corrosion de la roche, voire indirectement… dans la cristallisation.
Des données récoltées au cœur du gouffre
Voilà donc où nous en sommes en ce matin du 2 novembre, 10 heures, alors que se rejoignent dans le QG au-dessus de l’accueil les premiers membres de cette 2e expédition de 2021 au gouffre d’Esparros. La bonne humeur est au rendez-vous, le café et le pastis landais aussi (ne vous méprenez pas, c’est une brioche). En attendant le reste de l’équipe qui arrivera progressivement, François Bourges briefe Alexandre Honiat, étudiant en Master 2 de géologie à Toulouse et fervent pratiquant de spéléologie. « Tu vois, explique-t-il, ces sondes enregistrent les températures avec une résolution de 2 millièmes de degré. Sur ce support, il y aura une quinzaine de capteurs, on va l’immerger pour faire une intercalibration générale, pour être sûrs d’avoir de bonnes données de température. »
À l’autre bout de la table, Adrien Lorentz, le guide spéléo, remplit, comme tous les participants, les différents papiers permettant l’accès au Graal. Combinaison, baudrier, bottes, casque, sac et frontale enfilés, un dernier au revoir soufflé aux lumières chatoyantes de l’automne et nous voilà dans le tunnel menant à la cavité tant attendue. Les bruits semblent soudain étouffés sous une cloche de coton. Instinctivement, l’on se met à chuchoter, comme pour ne pas déranger le travail millénaire des gouttes sur la pierre. L’équipage s’enfonce dans la galerie principale. L’obscurité nous enveloppe, rassurante, intimidante. Les trésors surgissent à l’infini au détour d’un faisceau de frontale. Scintillement perpétuel d’une paroi ou d’un sol, délicatesse d’un corail de roche translucide, féerie d’un ciel de concrétions immaculées aux formes extravagantes… Difficile en ces lieux de ne pas perdre de vue l’objet de notre présence.

Il est prévu que François, épaulé d’Alexandre, récupère ses 16 sondes de température éparpillées dans la grotte, en prenant à chaque fois une photo de son emplacement et la mesure des taux locaux d’oxygène, de CO2, de radon et d’ionisation. Ces deux derniers étant bien plus élevés sous terre, leur mesure est un indicateur de l’aérologie, comme l’indique Bruno Lartiges. « Le radon permet de voir s’il y a des entrées d’air dans la grotte, parce qu’en hiver l’air froid est censé rentrer, renouveler l’air et ainsi diminuer le niveau de radon. » Ce gaz radioactif ayant de surcroît une fâcheuse tendance à se désintégrer en descendants solides irradiants qui peuvent se loger dans les poumons, il est important de surveiller le taux d'exposition des guides.



Au son du bipbip continu du compteur d’ionisation, Adrien se charge de récupérer les sondes de température du profil vertical de 50 mètres, 5 en rappel au fond d’un puits, 5 en remontée sur corde d’une paroi abrupte. La descente nécessite de s’y reprendre à deux fois, l’installation étant fichtrement vieille, et la corde des capteurs manifestement désireuse de rester accrochée à la roche.
Les chercheurs sur tous les fronts
À leur retour ébloui sur le plancher des vaches, vers 14 heures, quatre autres scientifiques sont arrivés. Ils seront rejoints un peu plus tard par les trois derniers membres de cette expédition. L’après-midi et le lendemain ne sont pas de tout repos. Jusqu’à cinq pôles de recherche sont actifs en même temps. François continue sur sa lancée. Dominique Genty et Stéphane Bujan, respectivement paléoclimatologue et ingénieur océanographe au laboratoire Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux2 (EPOC) de l’université de Bordeaux, enchaînent prélèvements simples et carottages pour d’éclairantes datations et analyses géochimiques. Ils sont accompagnés de Bruno Lartiges et Céline Pisapia, géobiologiste à l’Institut de physique du globe de Paris3 (IPGP), lorsque ceux-ci ne travaillent pas à la mise en route du 2e prototype de voile de Mylar visant à quantifier les infimes mouvements d’air.

Rémi Losno, chimiste de l’environnement et de l’atmosphère à l’IPGP, se concentre de son côté sur les compteurs de particules, qui quantifient les tout petits bouts de matière – calcite, polaire, peau… – en suspension dans l’air en fonction de leur taille. Ceci afin de s’assurer de la pureté de l’air et, plus récemment, de vérifier si l’on peut voir l’humidité en hauteur (oui, les particules y sont plus grosses !). Quant à Frédéric Perrier, enseignant-chercheur à l’IPGP et Bo Lei, post-doctorant au sein du même laboratoire, ils récupèrent sous terre d’autres sondes de radon et de température avant d’effectuer diverses mesures extérieures de radon. Coïncidence cocasse, chaque pôle, à un moment ou un autre, y va de son problème matériel, histoire de pimenter l’aventure. Rien de tel pour éprouver l’ingéniosité. On a alors le sentiment de voir à l’œuvre les premiers scientifiques de l’histoire, bricoleurs touche-à-tout, capables de tout créer et de tout réparer.
Il faudra des mois pour obtenir certains résultats de cette expédition, en particulier les précieuses datations, aussi fastidieuses que minutieuses. Mais nul doute que de passionnantes découvertes viendront s’ajouter au cumul impressionnant de données de ce groupe de chercheurs, présageant bon pour leur avenir... et celui de l’aragonite. ♦
-----------------------------------------------------------------------
Les stalagmites, championnes des archives paléoclimatiques
Les concrétions souterraines, autrement appelées spéléothèmes, sont les seules archives qui permettent de dater jusqu'à plus de 500 000 ans de façon précise, quand le carbone 14, lui, ne nous informe précisément que sur 50 000 ans. On compte pour cela, dans la calcite qui les compose, le nombre d’atomes d’uranium et de l’atome en lequel il se désintègre en un temps connu, le thorium. De la même manière, les proportions de 13C et de 12C, deux isotopes du carbone, indiquent qu’il y avait plus ou moins de végétation au-dessus de la grotte, et donc qu’il faisait plus ou moins froid, grâce à leurs taux très différents dans les deux sources de carbone des concrétions : le CO2 racinaire des végétaux et le calcaire rocheux. Quant aux proportions de 18O et de 16O, deux isotopes de l’oxygène, elles donnent une idée des circulations atmosphériques et des températures passées. La démonstration a même été faite d’une transposition quasi parfaite entre les résultats paléoclimatiques obtenus avec les stalagmites et ceux issus des carottes glaciaires du Groenland ! ♦