Vous êtes ici
Si les inventions nous étaient contées
–6000 avant notre ère : le miroir
Miroir, mon beau miroir, d’où viens-tu ? Impossible d’apporter une réponse précise s’il s’agit de donner la date à laquelle l’Homme a observé pour la première fois, au détour sans doute d’un cours d’eau, son reflet. Mais, dès lors que cette contemplation s’appuie sur un dispositif ad hoc, des pistes émergent : 6 000 ans avant notre ère, les habitants d’Anatolie utilisaient des morceaux taillés d’obsidienne, une pierre volcanique vitreuse ;
3 000 ans plus tard, l’emploi de cuivre poli est attesté en Mésopotamie, un millénaire avant que la Chine de la culture Qijia ne confectionne ses premiers miroirs en bronze, en alliant le cuivre à l’étain ; l’Égypte de la prestigieuse XVIIIe dynastie, celle des Amenhotep, Hatshepsout, Toutankhamon et autres Thoutmosis, se sert quant à elle d’un autre alliage, composé de cuivre et d’argent.
Dès ces époques, les miroirs recouvrent des préoccupations plus vastes que simplement esthétiques. Ils débouchent sur les premières observations scientifiques dans le domaine de l’optique : les images qu’ils renvoient sont inversées, la main droite y devient une main gauche, et si nul n’ignore ce phénomène, les savants ont été bien en peine de l’expliquer.
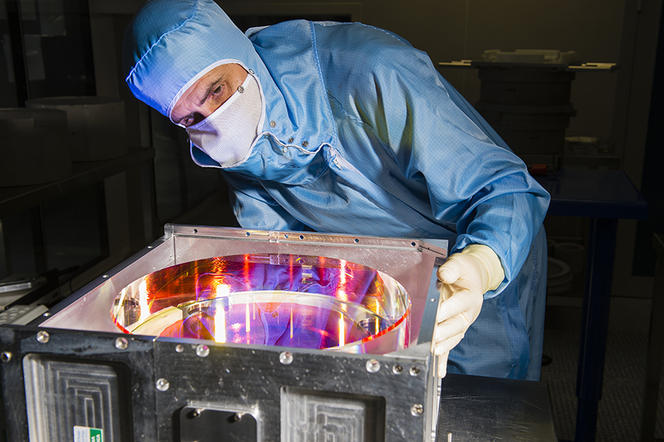
Ils investissent en parallèle la mythologie : il suffit de songer à Narcisse ou au combat de Persée et de Méduse, et à la manière dont le héros vient à bout de la terrible Gorgone en se servant de son reflet, pour en prendre la mesure. Ils peuvent aussi devenir des instruments militaires – les miroirs ardents d’Archimède – ou politique : Suétone raconte dans ses Vies des douze Césars que l’empereur Domitien avait couvert de phengite, un minéral réfléchissant de la famille des micas blancs, les murs des portiques où il se promenait, afin d’y surprendre d’éventuels assassins… peine perdue, puisqu’ils auront finalement raison de lui dans son cabinet de travail.
Quant aux philosophes, que n’ont-ils pas dit ou écrit au sujet des miroirs : Socrate, « le plus sage de tous les hommes, se servait d’un miroir même pour former aux bonnes mœurs », note Apulée dans son Apologie, car, prévient encore Sénèque, l’observation de son propre reflet ne sert pas seulement à l’embellissement physique, mais aussi au perfectionnement moral par une meilleure connaissance de soi-même. Pourtant, les miroirs d’alors étaient loin de la pureté du reflet que nous apercevons tous les matins dans nos salles de bains : pour en arriver là, il aura fallu encore bien des progrès, apportés par les verriers vénitiens de Murano de la fin du Moyen Âge, les artisans français du XVIIe siècle qui ont conçu la technique du coulage, et l’invention du miroir moderne, par application d’une fine couche d’argent sur le verre, due au chimiste allemand Justus von Liebig en 1835.
1642 : la machine à calculer
On a beau vanter les mérites de l’étude et du travail, certains n’arrivent jamais à acquérir la bosse des mathématiques, tandis que d’autres semblent naître avec, comme touchés par la grâce. Blaise Pascal, qui voit le jour en 1623 dans une famille de la noblesse de robe de Clermont, en Auvergne, est de ceux-là. Certes, dans sa biographie, la légende se mêle parfois à la réalité : « On a tant écrit sur lui, on l’a tant imaginé et si passionnément considéré qu’il en est devenu un personnage de tragédie », prévient Paul Valéry. Des aspects de sa biographie sont ainsi sujets à caution : a-t-il vraiment découvert les Éléments d’Euclide seul, à l’âge de 12 ans ? D’autres, en revanche, sont avérés, comme la rédaction d’un Essay pour les coniques à 16 ans, et la mise au point, trois ans plus tard, de la première machine à calculer mécanique, la « Pascaline ».
En 1639, Étienne Pascal, le père du jeune prodige, est nommé commissaire à la levée des impôts auprès de l’Intendant de Normandie, une charge lucrative mais très fastidieuse. Attristé de le voir se débattre à longueur de journée sous un déluge de chiffres, Blaise, qui a perdu sa mère à l’âge de 3 ans, entreprend de concevoir une machine arithmétique capable de le soulager d’une partie de son labeur. Le premier prototype, conçu en 1642 avec un système de roues pour chaque unité de numération, permet d’additionner les sommes à récolter.
La difficulté principale a consisté à résoudre le problème de la retenue, en mettant au point un système de sautoirs en cascade : arrivée à 9, chaque roue – des unités, des dizaines, des centaines… – doit ensuite pouvoir agir sur la suivante au cours de l’opération, afin que 9+1 ne donne pas 0 mais bien 10, que 99+1 n’aboutisse pas à 90 mais bien à 100, etc. Jusqu’à tout récemment, le principe élaboré par Pascal a d’ailleurs inspiré de nombreux instruments, tels que les compteurs kilométriques des véhicules – avant leur remplacement par des dispositifs électroniques.
Mais les impôts ne font pas que s’additionner : souvent, ils se multiplient, hélas ! Et, bien que plus rarement de mémoire de contribuable, il leur arrive aussi de se soustraire, voire de se diviser… Les prototypes suivants de la Pascaline prennent en compte toutes ces opérations, la soustraction par la méthode simple d’addition du complémentaire, la multiplication de façon un peu plus compliquée sous la forme d’une suite d’additions, et la division ne manière moins évidente encore par une suite de multiplications et de soustractions. En 1645, l’inventeur est en mesure de dédier sa machine « pour faire toutes sortes d’opérations d’arithmétique par un mouvement réglé sans plume ni jetons » à Pierre Séguier : l’exemplaire offert au chancelier de France est toujours visible à Paris, dans les collections du musée des Arts et Métiers.
1917 : le char
L’utilisation du char de combat est une pratique ancienne, attestée en Mésopotamie dès le milieu du troisième millénaire avant notre ère – de beaux spécimens figurent sur la « face de la guerre » du célèbre étendard d’Ur. Et l’idée de lui adjoindre un blindage, bien que beaucoup plus récente, ne date pas d’hier non plus : Léonard de Vinci l’a imaginée dès 1482, en proposant à Ludovic Sforza de concevoir des engins circulaires en bois, véritables tours mobiles, bardées de plaques de métal et équipées de roues et de canons, qui pouvaient, avec huit hommes à leur bord et en moins de temps qu’il n’en fallait pour le dire, désorganiser les rangs ennemis. En somme, le char d’assaut moderne, qui fait son apparition sur les champs de bataille en avril 1917, n’a rien inventé, pas même la chenille, dont la paternité revient à l’Américain Benjamin Holt, qui l’a conçue pour équiper les engins agricoles, et brevetée le 19 décembre 1907.
Si toutes les conditions étaient déjà réunies bien avant le déclenchement de la Grande Guerre, pourquoi son emploi a-t-il tant tardé ? Tout d’abord, pour des raisons de conceptions stratégiques : en août 1914, en France surtout, l’état-major est encore convaincu de la supériorité des belles manœuvres de cavalerie et d’infanterie. Le résultat ne se fait pas attendre : le 22 août 1914, les troupes françaises dans leurs pantalons garance chargent à la baïonnette les positions allemandes à Charleroi, et perdent 27 000 soldats en une seule journée ! Peu à peu, à mesure que les belligérants se retranchent pour éviter de reproduire de telles hécatombes, quelques officiers, à l’image du colonel d’artillerie Jean Estienne, suggèrent de recourir à des véhicules blindés. Mais l’affaire n’est pas aisée : les champs de bataille se sont transformés en une longue ligne
de front, parsemée de trous d’obus, couverte de boue, traversée de barbelés… créer des véhicules capables de franchir sans mal et sans casse le no man’s land relève de la gageure. Dès 1915, les Britanniques tout d’abord, puis les Français, initient plusieurs projets, qui ne donnent encore que des résultats mitigés : les premiers engins, trop lents, trop lourds, trop peu maniables, constituent des cibles de choix pour les artilleurs ennemis. Le 16 avril 1917, lors de l’offensive du Chemin des Dames, 76 des 128 chars engagés à Berry-au-Bac sont perdus.

Le salut vient finalement d’un projet développé en parallèle par le général Estienne – il a été promu en 1916 – et l’entrepreneur Louis Renault, avec la production d’un char léger, le FT-17, équipé d’un canon de 37 mm et d’une mitrailleuse. Avec deux occupants à son bord, il peut s’élancer à 8 km/h. Surtout, produit en masse à plus de trois mille exemplaires, il sature littéralement le dispositif adverse qui, à partir de l’été 1918, est débordé de toutes parts. Victoire au char !
Demain : le traducteur pour animaux
Qui n’a pas rêvé un jour de comprendre le langage des animaux, et de pouvoir dialoguer tranquillement avec son chien, son chat ou son canari – pour le poisson rouge, c’est une autre paire de manches. En 2010, Google a trouvé la solution : un traducteur automatique qui transforme les miaulements, aboiements, grognements, bêlements, gazouillis etc. en paroles humaines. Une vidéo de démonstration a même été diffusée par la société : elle montre un développeur présentant le dispositif à un fermier, médusé d’entendre les appréciations d’un porc sur la nourriture qui vient de lui être servie… Hallucinant ! Sauf pour celles et ceux qui avaient repéré la date de mise en ligne de cette séquence, le 1er avril : un beau canular !
Mais c’est bien connu : rien n’arrête les nouvelles technologies, et la plaisanterie pourrait devenir réalité grâce à un projet lancé par Amazon en juillet 2017. Le géant de Seattle a en effet annoncé la mise en chantier d’un « pet translator » – pour les non anglophones, on s’empressera de préciser que pet signifie « animal de compagnie » ! Une étude a même été commandée à des experts, dont Will Higham, un behavioural futurist – bien que l’expression n’existe pas encore en français, on pourrait traduire par « futurologue du comportement », tout un programme. Et l’éminent spécialiste, qui se présente lui-même sur son site web comme l’un des savants les plus respectés de sa profession – mais combien sont-ils à l’exercer ? – promet un aboutissement en 2027.

Il puise son assurance dans les travaux de Constantine Slobodchikoff, un professeur en biologie de l’Université Nothern Arizona, qui étudie depuis plus de trente ans les chiens de prairie et a pu observer la complexité de leur système de communication. Selon lui, les petits rongeurs auraient notamment une expression pour désigner chaque menace, un rapace dans le ciel, un coyote sur terre, un âne au volant d’un véhicule lancé à vive allure…
Les prévisions de Will Higham, qui a déjà « informé des milliers de businessmen » sur les marchés d’avenir – toujours selon son propre site – laissent toutefois le reste de la communauté savante plus que sceptique… Par son entremise, Amazon ne chercherait-il pas à créer un nouveau besoin sur le marché déjà bien juteux des animaux de compagnie ? Non, vous croyez ? Et même si par miracle l’invention voit le jour dans dix, cinquante ou cent ans, elle ne pourra jamais traduire l’expression corporelle très complexe des animaux. Et à la réflexion, après tout ce que nous avons fait aux animaux, et ce que nous continuons de leur faire subir – des chercheurs beaucoup plus sérieux parlent tout de même d’une « sixième extinction massive » en cours – est-on bien sûr de vouloir entendre ce qu’ils ont à nous dire ?
À lire :
Denis Guthleben, La Fabuleuse Histoire des inventions, Dunod, octobre 2018, 352 pages, 22 €.
Mots-clés
À lire / À voir

Denis Guthleben, La Fabuleuse Histoire des inventions, Dunod, octobre 2018, 352 pages, 22 €.
Plus d'infos sur le site de l'éditeur













