Vous êtes ici
Peut-on échapper au syndrome de l’innovation permanente ?
La course permanente à l’innovation qui implique de relever de multiples défis technologiques, de la biologie de synthèse aux nanotechnologies (on peut rajouter autre chose…), conduit inévitablement à l’épuisement des ressources et à la pollution. Parallèlement, nous sommes confrontés à la solitude au travail dans l’oubli du sens des métiers et dans l’automatisation normalisée des gestes. Nous nous épuisons également. Cette situation, souvent décrite, paraît largement inéluctable ou, du moins, les réponses ne s’imposent pas avec évidence. Bien au contraire. D’année en année, les difficultés croissent quoique les appels à l’innovation se multiplient dans la dépense et l’effervescence. Pourquoi en est-il ainsi et peut-on, d’une façon ou d’une autre, échapper à ce qui s’affirme comme inéluctable ?
L’innovation permanente pousse à consommer toujours plus
L’impression que la situation est plus ou moins sans issue est liée au fait qu’il semble impossible de penser autrement qu’en termes d’innovation et de progrès technologiques. Nous rappelons que le terme « innovation », sans cesse agité aujourd’hui dans les différentes sphères de la société, désigne en général des inventions destinées à fournir aux citoyens devenus consommateurs des services et des appareils nouveaux, le plus souvent seulement partiellement améliorés. L’innovation correspond aussi à la mise au point de méthodes de production ou de distribution conduisant principalement, par l’automatisation normalisée des tâches, à une réduction du temps de travail tout en garantissant une plus grande productivité. L’innovation, devenue ces derniers temps « innovation permanente », c’est donc toujours, dans un cas comme dans l’autre, du plus à consommer et à produire.
Or ce type d’approche, ancré dans l’insuffisant et justifiant l’insuffisant, est consubstantiel à l’idée que nous nous faisons de la nature depuis deux ou trois siècles. Que voulons-nous dire ici ? Qu’il n’est envisageable de répondre aux problèmes posés actuellement qu’en prenant enfin conscience qu’il n’y a pas de nature en soi, et que l’idée que nous nous faisons de la nature, l’homme y compris, s’est constituée progressivement depuis la fin du XVIᵉ siècle, et plus spécialement au XIXᵉ siècle.
L’homme considère la nature comme un entrepôt où puiser sans fin
Nous avons l’habitude de voir dans la nature une entité totalement indépendante de nous, subsistant par elle-même. Une telle nature n’existe pas. L’idée que nous nous faisons de la nature est une construction, le résultat d’un rapport complexe de l’homme avec ce qu’il conçoit comme un extérieur. Cette idée de la nature depuis le XIXᵉ siècle est très différente de celle qui précédait immédiatement et radicalement étrangère à celles qui prévalaient avant le XVIIᵉ siècle.
de la nature, l’homme y compris, s’est constituée progressivement.
Prenons un exemple du côté de la technique pour éclairer cela. Au XIXᵉ siècle, après les travaux de Gustave-Gaspard Coriolis (1792-1843) et de Hermann von Helmholtz (1821-1894), l’eau, l’air, les animaux, les hommes et la Terre sont comme obligés, mis en demeure de livrer leur énergie afin qu’elle soit récupérée, tirée, accumulée, mise en réserve et vendue. Cela ne se réalisait-il pas déjà dans un ancien moulin à eau ? Non, la roue du moulin tourne, entraînée directement par le courant dont on sait mesurer la force. Or, si le moulin met bien à notre disposition le mouvement de l’eau pour moudre les grains, il n’y a pas dans ce geste technique l’ambition d’extraire, d’accumuler et de mettre en réserve à partir du mouvement de l’eau une énergie susceptible d’être à son tour distribuée et vendue. Ainsi l’utilisation dans le moulin de la force de l’eau ou du vent laisse inchangé le milieu, l’eau ou le vent.
En revanche, les nouvelles techniques du XIXᵉ siècle imposent aux sources d’énergie de se soumettre à la production en se consumant et en s’épuisant (pour le charbon et le pétrole entre autres). En un mot, la croûte terrestre se dévoile comme un champ pétrolifère et non plus comme terre. Le sol est un entrepôt où l’on vient s’approvisionner jusqu’à épuisement en s’armant toujours de nouvelles techniques innovantes accroissant toujours l’épuisement (le fond des mers n’est pas non plus épargné). Parce qu’elle procède de l’idée que nous nous faisons de la nature – un entrepôt où puiser sans fin –, l’innovation nous entraîne toujours dans un mouvement irresponsable, dans une fuite en avant sans fin dénommée progrès, dictée par une logique inhérente de l’intérêt, de l’excès, de l’insuffisant et de l’autodépassement. Enfermés que nous sommes dans cette idée de la nature, tout nous paraît inéluctable.
Il faut sortir du cercle vicieux de la fausse exigence technique
Il convient, pour éviter l’épuisement, le nôtre comme celui de la nature, pour éviter notre mort qui ne sera pas durable comme le développement, de porter un nouveau regard sur le monde de l’innovation technique permanente, un nouveau regard pour sortir du cercle vicieux de l’innovation, de la fausse exigence technique qui fixe a priori notre avenir et notre destin sans nous. Que souhaitons-nous pour notre vie ? Y a-t-il nécessité à innover du côté de la biologie de synthèse, des nanotechnologies ou du énième gadget électronique ? D’autres choix ne s’imposeraient-ils pas pour notre vie dans le monde ? En un mot, comme le rappelle Hannah Arendt, nous devons « assumer, si nous l’aimons assez, la responsabilité du monde »1. Il est, le monde, de notre responsabilité. Une responsabilité qu’il convient de reprendre au nom de notre existence afin de poser – peut-être est-il déjà trop tard – un regard extérieur sur cette idée de nature assujettie à l’épuisant et mortifère appel à l’innovation permanente.
- 1. Hannah Arendt, La Crise de la culture, Gallimard, 2002, p. 251.
À lire / À voir
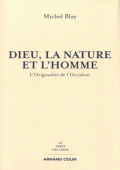
Dieu, la nature et l’homme. L’originalité de l’Occident, Michel Blay, Armand Colin, coll. « Le temps des idées », 2013







