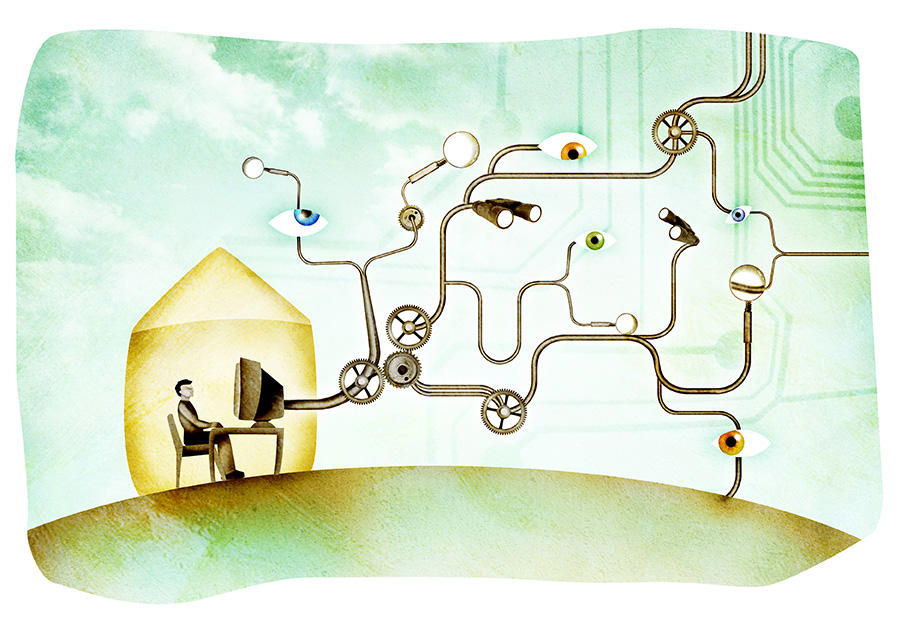Vous êtes ici
« Le droit n’est jamais impuissant »

Quels sont les enjeux des États généraux de la recherche sur le droit et la justice qui débutent lundi prochain ?
Florence Renucci1 : L’idée est de permettre à tous les acteurs du monde judiciaire de réfléchir ensemble aux grandes problématiques d’aujourd’hui et de demain. À l’origine, la « Mission de recherche Droit et Justice » a été créée en 1994, sous forme de groupement d’intérêt public. Il s’agissait de créer une passerelle entre le monde de la recherche et le ministère de la Justice, mais qui ne soit pas subordonnée à ce dernier – pour ne pas être « juge et partie »… Ce groupement a organisé une grande manifestation sur l’avenir de la recherche juridique en 2005, publié sous forme de recueil deux ans plus tard. Nous avons souhaité rééditer cet événement de façon plus globale, en collaboration avec le secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche : durant quatre jours, nous allons tenter de faire un bilan de ces quelque dix dernières années de recherche, mais aussi aborder les questions émergentes et les pratiques judiciaires tentant d’y répondre. Nous allons également réfléchir à la formation des juristes et à l’enseignement du droit, en France et dans le monde.
Comment avez-vous décidé des questions dignes d’intérêt et celles qui le seraient moins ?
F. R. : Nous avons tout simplement recensé les thèmes actuels de recherches – celles que nous finançons et celles portées par l’Agence nationale de la recherche et l’Europe. Dans un second temps, nous avons soumis un projet de programme aux participants des États généraux : universitaires, professionnels du droit, décideurs publics… L’idée des États généraux est notamment de permettre à ces différents univers d’échanger, car ils n’en ont que rarement l’occasion le reste du temps. Tout le monde gagne à s’enrichir de l’expertise scientifique des uns et de l’expérience de terrain des autres ! Au fil des échanges, nous avons constaté que beaucoup de questions revenaient et qu’elles étaient naturellement liées aux tendances fortes de ces dernières années : la mondialisation, les nouvelles technologies ou la montée des préoccupations environnementales par exemple.
Dans le cadre de la mondialisation, le droit national peut-il encore être respecté ?
F. R. : Contrairement à une idée reçue, le droit est flexible et peut toujours s’adapter. Il est certes difficile de trouver des réponses adaptées, mais il ne faut pas croire que rien n’est possible pour autant. Depuis plusieurs années maintenant, nous constatons une augmentation des conflits entre des intérêts économiques privés et des États, comme l’illustre, par exemple, le développement de tribunaux arbitraux pour solder des litiges judiciaires entre des pays et de grandes entreprises.
Historiquement, de telles luttes de pouvoir ne sont pas neuves, mais elles se sont multipliées au fil de la mondialisation, de la multiplication des échanges transnationaux ou de l’ouverture des frontières. Cette globalisation du droit a entraîné l’émergence de nouveaux acteurs, comme les tribunaux arbitraux donc, mais aussi des institutions telles que la Cour européenne des droits de l’homme ou la cour pénale internationale. Nous disposons déjà d’une jurisprudence, d’un droit international et de codes de gouvernance, mais il semble nécessaire de les repenser pour faire face à l’ampleur que prennent ces questions aujourd’hui.
Y a-t-il plus généralement un recul du droit étatique face à des revendications privées ?
F. R. : Traditionnellement, en effet, il existe un contrôle fort de l’État sur les individus par l’entremise d’un droit coercitif. Or on assiste depuis plusieurs années à une plus grande prise en compte des injonctions individuelles. Pour prendre un exemple concret, l’état civil d’une personne – son identité juridique – est longtemps resté immuable. On pouvait, par exemple, changer de nom lorsqu’il était jugé préjudiciable… Aujourd’hui, le droit de changer de nom, de sexe, d’être reconnu comme parent lorsqu’on est beau-parent ou homosexuel, etc., tout cela se voit peu à peu reconnu au fil des revendications. Cette meilleure prise en compte des demandes individuelles se traduit également par la montée en puissance de règles relevant davantage du conseil et de la bonne pratique que de l’interdiction stricte. Sur Internet par exemple, on assiste de façon parallèle à une perte de contrôle de l’État et à une intervention croissante des acteurs privés, notamment pour tout ce qui touche à la diffamation, l’injure ou la diffusion de fausses informations. Plutôt que de recourir à une procédure judiciaire, on laisse les entreprises du net régler elles-mêmes les problèmes au cas par cas. Il faut toutefois préciser que les pouvoirs publics tentent parallèlement d’établir des règles générales dans ce secteur : ainsi, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique offre des outils de protection des citoyens face aux réseaux sociaux, posant les bases d’un « droit à l’oubli numérique ».
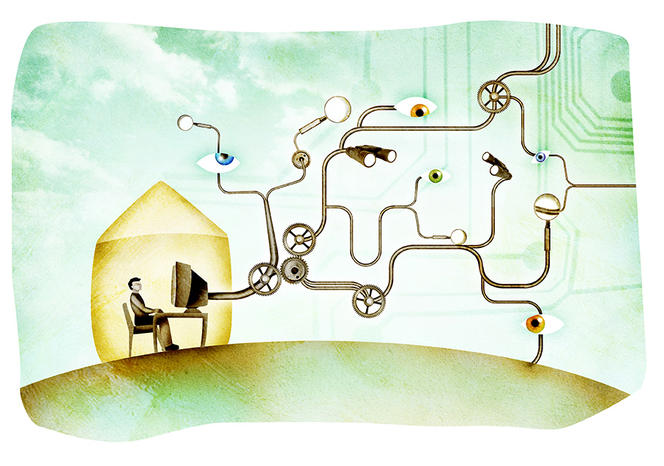
D’autres questions plus « prospectives » sont-elles soulevées par les développements technologiques et numériques ?
F. R. : Le respect de la vie privée suscite de nombreuses interrogations depuis l’émergence d’un Web social. Actuellement, nous nous demandons notamment comment le droit peut encadrer de nouveaux dispositifs comme la reconnaissance faciale et plus généralement ce qui a trait à la « réalité augmentée » : potentiellement, si vous êtes filmé dans la rue à votre insu, un logiciel pourrait vous reconnaître, géolocaliser votre position, identifier ce que vous faites… Et tout se retrouverait en ligne contre votre gré.
Un autre sujet majeur, que nous aborderons aux États généraux, et la question de la prédictivité et du big data. Pour résumer, des logiciels permettant d’analyser toute une jurisprudence afin d’en déduire automatiquement une décision de justice sont en cours de développement. C’est un sujet ambivalent : d’un côté, cela pourrait aider les juges à analyser rapidement un dossier et ainsi contribuer à désengorger les tribunaux. En même temps, il ne faudrait pas que la dimension humaine passe au second plan lors des procès. Nous devons réfléchir à la place que peuvent occuper de tels dispositifs dans une procédure judiciaire.
Les événements liés au terrorisme seront-ils abordés ?
F. R. : Indirectement, oui. Nous avons prévu un atelier sur le thème de la radicalisation et une table ronde sur la notion de dangerosité ; mais nous élargissons à toutes les formes de violences ou d’attentat, et pas seulement celles qui ont frappé la France ces dernières années. Ce qui nous intéresse, c’est que les notions de « radicalisation » et de « dangerosité » sont de plus en plus présentes alors qu’elles ne sont pas réellement des concepts juridiques. Jusque récemment, on les retrouvait tout au plus en filigrane et appréhendées de manière objective, par exemple à travers l’idée qu’un crime témoigne d’une plus grande dangerosité qu’un délit. Depuis les années 1990, ces notions ont tendance à s’immiscer dans des textes de droit. En 2008 par exemple, a été introduite la rétention de sûreté : un individu ayant purgé sa peine pouvait néanmoins être placé dans un centre social médico-judiciaire s’il était considéré comme particulièrement dangereux. Cette évolution tend à substituer une logique de contrôle permanent à un système fondée sur la peine et la remise en liberté. Nous devons là aussi y réfléchir, car il y a un risque réel d’atteinte aux libertés fondamentales. Les pénalistes tentent d’alerter le grand public depuis plusieurs années, mais ils peinent à se faire entendre dans le contexte actuel.
Les peines alternatives à l’incarcération entrent-elles dans ce cadre ?
F. R. : Non, c’est un sujet très différent. L’idée de la table ronde dédiée est de faire le point sur les traitements en milieu ouvert en lieu et place de l’incarcération, et notamment d’évoquer la « contrainte pénale » mise en place par Christiane Taubira, soit la possibilité pour un condamné de bénéficier d’un accompagnement spécial. Nous savons depuis longtemps que l’incarcération n’est pas nécessairement la meilleure façon de permettre à un individu de sortir de la délinquance ou de la criminalité, a fortiori dans un contexte de surpopulation carcérale. Mais l’idée des États généraux est précisément de prendre à bras-le-corps des sujets émergents pour mieux anticiper l’avenir et préparer un cadre judiciaire adapté.
Pour assister en direct aux États généraux de la recherche sur le droit et la justice, rendez-vous ici.
- 1. Directrice de recherche au centre d’histoire judiciaire de Lille (unité CNRS/Université de Lille 2) et directrice adjointe de la Mission de recherche droit et justice.
Voir aussi
Auteur
Formé à l’École supérieure de journalisme de Lille, Fabien Trécourt travaille pour la presse magazine spécialisée et généraliste. Il a notamment collaboré aux titres Sciences humaines, Philosophie magazine, Cerveau & Psycho, Sciences et Avenir ou encore Ça m’intéresse.