Vous êtes ici
Portraits croisés du Moyen-Orient

Les révolutions arabes et les conflits actuels mettent le Moyen-Orient et les mondes musulmans au cœur de l’actualité. Selon vous, qui êtes la nouvelle directrice adjointe du groupement d’intérêt scientifique (GIS) centré sur cette « aire culturelle », quels sont les sujets de recherche les plus importants ou innovants de ces dernières années ?
Mercedes Volait : Les études sur la Turquie connaissent un essor remarquable que le projet, désormais avorté, de rapprochement avec l’Europe a certainement stimulé au départ ; elles sont actuellement confrontées à toutes les formes de violence politique que connaît le pays. Les « printemps arabes » ont évidemment suscité beaucoup d’attentes, d’interrogations et de perplexité, et conduit les chercheurs à s’intéresser de plus près à des sujets tels que l’utilisation des réseaux sociaux ou l’invention d’une contre-culture dans des régimes très autoritaires. Il est fascinant de voir, en Arabie saoudite ou en Iran par exemple, les libertés qui peuvent être prises dans l’espace privé. Parallèlement, il y a eu un vif intérêt pour les questions liées à la sexualité, à la fabrique du genre et au féminisme au Moyen-Orient. Mais l’attrait pour des sujets qui ne sont pas directement connectés à l’actualité, comme l’étude des pratiques alimentaires au Moyen Âge ou de tout ce qui touche à la langue parlée et écrite1, reste fort. À la suite du bilan dressé par le GIS dans son livre blanc – rédigé entre 2013 et 2014 –, l’islamologie renaît peu à peu. Il faudra du temps, bien sûr, car c’est une discipline particulièrement exigeante : il ne suffit pas d’apprendre l’arabe, mais il faut se plonger dans l’exégèse des textes coraniques… Cela prend des années !
Comment concilier ce « temps long » de la recherche et l’incitation exercée par la société à répondre aux questions sur l’islamisme, le djihadisme ou encore la radicalisation ?
M. V. : Il y a deux attitudes : certains chercheurs sont plus enclins à aborder des questions d’actualité brûlante, à prendre la parole dans le débat public, à travers les médias notamment, mais ils sont minoritaires.
Les autres préfèrent rester en retrait car il est souvent extrêmement difficile d’exposer une situation complexe dans le cadre médiatique. Bien sûr, il est possible d’essayer de donner un éclairage sur la crise que traverse la Turquie ou sur les élections iraniennes, par exemple. Mais il faudrait pouvoir exposer d’abord quelques bases avant d’entrer dans le vif du sujet, et ce n’est pas toujours évident dans l’espace médiatique.
Par exemple, un grand nombre de Français sont convaincus que les Turcs et les Iraniens parlent arabe et sont du même coup arabes, or ce n’est pas le cas2 ! Beaucoup de chercheurs pensent d’ailleurs que la compréhension de l’actualité sera bien meilleure au sein de la population lorsque quelques fondamentaux de ce type seront mieux intégrés à notre culture générale. C’est aussi pour cela que le travail du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans paraît essentiel.
L’intitulé même de votre groupement de recherche n’est pas une évidence pour tout un chacun : que sont « le Moyen-Orient et les mondes musulmans » ?
M. V. : La question n’a rien de simpliste en effet et, en réalité, on ne peut pas y répondre de façon tranchée. Nous avons donc opté pour une définition aussi large que possible : il s’agit de la zone allant du Maghreb à l’Indonésie, en incluant les populations de confession musulmane, qui vivent par exemple en Europe ou aux États-Unis. L’enjeu était tout à la fois de créer un corrélat avec l’expression américaine « Middle East » (afin d’établir des ponts avec la recherche anglo-saxonne), d’inclure les pays du Maghreb, et aussi de pouvoir travailler sur les musulmans vivant hors de ces pays. Nous tenons compte du fait géographique, du fait culturel (se situant entre culture et religion, l’Islam est ambivalent à cet égard), et nous nous intéressons également aux populations non musulmanes ou aux groupes minoritaires et/ou hétérodoxes dans des pays où l’islam est la religion majoritaire, comme les chrétiens d’Orient ou les alévis en Turquie, par exemple. L’idée est davantage de fédérer les équipes françaises, d’encourager la pluridisciplinarité, plutôt que de définir un champ strict, qui pourrait être excluant en pratique.

Le GIS a été créé en janvier 2013 pour rassembler historiens, géographes, politologues, islamologues, linguistes et autres spécialistes des mondes arabes, musulmans, et du Moyen-Orient. Y avait-il de graves manques dans les études sur cette aire culturelle ?
M. V. : Le livre blanc sur les études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, a fait état d’une situation plus difficile qu’on ne pouvait le croire. Bien que la France soit traditionnellement très présente, il n’y avait quasiment plus d’islamologue, et très peu de chercheurs étaient habilités à diriger des thèses sur l’histoire du monde arabe. Dans ma propre contribution, j’ai rappelé que peu d’enseignants en histoire de l’art ou en archéologie sont spécialistes de l’Islam. Nous disposons de collections extraordinaires, mais bien peu de personnes ont les compétences nécessaires pour les étudier ! C’est notamment une difficulté propre à l’université française : nous formons beaucoup d’experts pour la France et l’Europe, moins pour d’autres cultures. Nous ne bénéficions d’ailleurs pas d’un système performant en matière d’apprentissage des langues, ce qui complique encore les choses. Le GIS a permis d’inciter au recrutement d’une quinzaine d’enseignants-chercheurs pour combler les manques, mais il reste encore beaucoup à faire. D’autant que la France dispose d’une implantation extraordinaire au Maghreb et au Moyen-Orient et d’accès facilités aux institutions et aux collections locales.
Quel est l’intérêt de se concentrer sur des aires géographiques et culturelles plutôt que de se contenter d’une approche plus traditionnelle par champ disciplinaire ?
M. V. : C’est une autre façon de travailler. Un politologue « généraliste », non spécialisé sur une aire culturelle, est en réalité spécialiste du monde français ou européen. Ou alors il travaille à partir de modèles théoriques supposés s’appliquer à n’importe quel environnement. Tandis que penser la recherche en termes d’aire culturelle nous pousse à reconnaître que notre point de vue est toujours un tant soit peu situé, ancré dans notre propre culture, et cela oblige à travailler à partir d’enquêtes de terrain très poussées avant d’élaborer des hypothèses. Si vous travaillez sur l’architecture égyptienne, par exemple, vous ne pouvez pas faire l’économie d’une immersion dans l’histoire, la langue ou encore la culture de ce pays. Enfin, c’est aussi une autre façon d’envisager les collaborations scientifiques : personnellement, en tant qu’historienne de l’art dans le monde arabe, spécialiste de l’Égypte moderne, j’ai plus d’affinités avec un politologue ou un anthropologue travaillant sur la même aire culturelle qu’avec un historien de l’art qui se consacre à la Renaissance italienne.
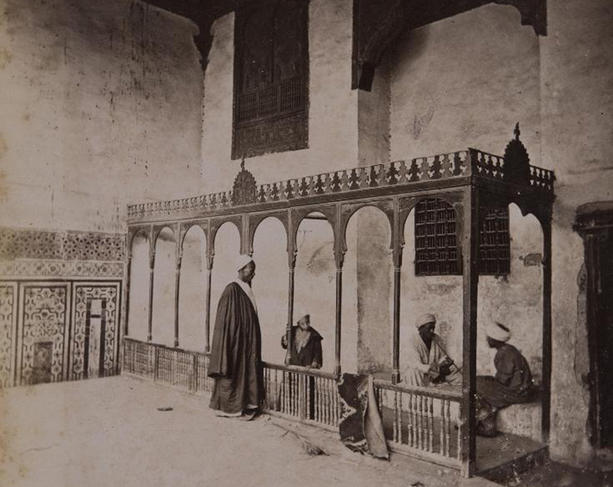
Cette approche par aire culturelle contribue-t-elle à l’internationalisation des recherches françaises en sciences humaines et sociales ?
M. V. : Les études par aire culturelle poussent naturellement à l’internationalisation des projets et des collaborations.
Il paraît nécessaire de travailler avec des Égyptiens, des Turcs ou encore des Indonésiens lorsque votre recherche porte sur l’adaptation de l’islam aux traditions locales par exemple. À l’inverse, un spécialiste de l’industrie textile dans le nord de la France sera moins poussé à développer ce type d’échanges.
Nous sommes donc tous très internationalisés au sein du GIS : nous rencontrons des chercheurs de tous pays, issus du monde arabo-musulman, moyen-oriental, ou spécialistes de ces régions.
Les échanges d’informations et les communications entre des labos du monde entier sont constants. De jeunes doctorants se rendent régulièrement dans des centres de recherche locaux et nous en accueillons également. Outre l’aspect collaboratif et le gain de visibilité pour la recherche française, cette situation nourrit entre les chercheurs des échanges informels qui génèrent de nouveaux projets à long terme. Une meilleure circulation des individus et de l’information est toujours une source de progrès scientifique.
Consultez le programme du 2e Congrès Moyen-Orient et mondes musulmans qui se tient à l’Inalco, à Paris, du 5 au 8 juillet 2017.
- 1. Par exemple, l’abandon en Turquie de la graphie arabe pour une graphie latine en 1928, la question de la littérature en arabe dialectal, etc.
- 2. Les Iraniens parlent le persan et les Turcs, le turc. Ces deux langues partagent avec l'arabe certains vocabulaires mais elles ont des structures radicalement différentes de l’arabe.
Voir aussi
Auteur
Formé à l’École supérieure de journalisme de Lille, Fabien Trécourt travaille pour la presse magazine spécialisée et généraliste. Il a notamment collaboré aux titres Sciences humaines, Philosophie magazine, Cerveau & Psycho, Sciences et Avenir ou encore Ça m’intéresse.
















