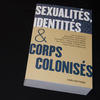Vous êtes ici
Regard sur la traite des êtres humains en France

Votre livre, La Traite des êtres humains en France, paru il y a quelques semaines, est le fruit d’une longue enquête sociologique sur ce phénomène encore mal connu. Qu’entend-on exactement par « traite des êtres humains » et quelle en est l’ampleur aujourd’hui ?
Milena Jakšić1 : La traite des êtres humains est un phénomène polymorphe qui recouvre des réalités aussi différentes que l’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage ou le prélèvement d’organes. Cette définition, fixée par le protocole de Palerme, adopté en 2000 par les Nations unies et ratifié par la France en 2002, met l’accent sur la déshumanisation qui résulte de la réduction de l’être humain à une marchandise vendue et achetée. Quantitativement parlant, 4 millions de victimes, à l’échelle mondiale, est l’estimation le plus souvent citée par les organisations internationales. Mais on ne sait rien des conditions de production de ce chiffre qui sert surtout à ériger un phénomène clandestin en problème public et à soulever l’indignation de l’opinion. De même, les associations parlent de plusieurs milliers de victimes en France. Mais là encore, on ne dispose pas de statistiques fiables.
Votre enquête se focalise sur la manière dont les prostituées migrantes en situation irrégulière peuvent être reconnues comme des victimes de la traite, mais ne le sont pas toujours. Quel a été l’élément déclencheur de ce travail ?
M. J. : Il remonte au début de mes recherches sur les victimes de la traite à finalité d'exploitation sexuelle, en 2005, quand j’ai découvert avec étonnement que presque aucune affaire de traite n’était portée devant les tribunaux français. C’est particulièrement étrange quand on sait que cette forme de criminalité est considérée comme l’une des pires atteintes aux droits de l’homme et que le délit de traite a été introduit dans le Code pénal en mars 2003. J’ai voulu élucider ce paradoxe. Plutôt que de décrire les trajectoires migratoires de prostituées victimes de la traite (qui sont-elles ? d’où viennent-elles ? qui sont leurs souteneurs ? etc.), j’ai centré mon enquête sur les différentes instances qui prennent en charge ces femmes, pour la plupart originaires des pays de l’Europe de l’Est ou du Nigeria, et qui reconnaissent ou non la réalité des violences subies.
avec étonnement
que presque
aucune affaire
de traite n’était
portée devant
les tribunaux
français.
En vous lisant, on découvre que faire valoir sa condition de victime de la traite et bénéficier de certains droits, comme un titre de séjour ou la Sécurité sociale, est tout sauf simple quand on est une prostituée migrante sans papiers en France.
M. J. : Effectivement. De très nombreuses contraintes émaillent le parcours d’une victime de la traite avant qu’elle n’obtienne une éventuelle régularisation. Pour commencer, elle doit porter plainte ou accepter de témoigner auprès de la Brigade de répression du proxénétisme (BRP) et/ou de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH). Or cette dénonciation, quand une victime d’exploitation est interpellée pour une entrée irrégulière sur le territoire français par exemple, se déroule dans le cadre d’une garde à vue où tout refus de sa part de coopérer la conduit à un placement en centre de rétention et, en général, à l’expulsion. Par ailleurs, dénoncer son souteneur, c’est-à-dire quelqu’un qui vous menace de représailles, vous et votre famille restée au pays, si vous le mettez en cause, n’est jamais chose aisée.
Le parcours des victimes qui veulent être reconnues est jalonné d’autres épreuves, notamment quand elles ont affaire aux associations qui interviennent soit à l’initiative des prostituées elles-mêmes, soit à la demande des policiers ou des magistrats dans le cadre d’une affaire de proxénétisme…
M. J. : Les associations de soutien et d'accompagnement des personnes prostituées sont contraintes d’effectuer un gros travail de tri entre les dossiers recevables et irrecevables. Distinguer les victimes avérées de la traite leur permet de défendre ces dernières avec des preuves solides et de conserver ainsi leur crédibilité auprès des pouvoirs publics. Mais certaines victimes vivent très mal les entretiens avec les travailleurs sociaux de ces associations. Elles les comparent à de véritables interrogatoires policiers. Cette réaction négative peut aller jusqu’au refus de raconter leur histoire, quitte à rester sans papiers.
L’étape suivante se déroule à la préfecture de police. Quelle est sa particularité ?
M. J. : La préfecture est l’institution qui délivre aux victimes de la traite une autorisation provisoire de séjour de six mois ou un titre de séjour d’un an. Ces documents authentifient leur qualité de victime et leur permettent, entre autres, de séjourner légalement en France et de bénéficier d’une couverture sociale. Mais, bien que la loi ne conditionne pas l’obtention d’un titre de séjour à l’arrêt de l’activité prostitutionnelle, les agents de la préfecture cherchent à s’assurer que les victimes de la traite ont quitté la prostitution et sont à la recherche d’un travail « décent ». Du coup, une victime qui, après avoir échappé à l’emprise de son souteneur, choisit librement de se prostituer (parfois parce qu’elle n’a pas d’autres choix), a peu de chances d’obtenir un titre de séjour.
Lors du procès des souteneurs et de leurs complices, aboutissement de ce difficile parcours, les victimes de la traite bénéficient-elles d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière ?
M. J. : Non. Cela signifie qu’elles risquent de croiser leur ancien souteneur dans les couloirs ou les toilettes du tribunal pendant les pauses cigarettes ! Cela explique que la plupart d’entre elles préfèrent ne pas se présenter aux audiences. Pire : celles qui acceptent de venir témoigner à la barre sont toujours soupçonnées de mentir et sont stigmatisées comme « putains ».
Toutes ces contraintes suffisent-elles à expliquer la difficile identification des victimes de la traite en France ?
M. J. : Cette bureaucratie pesante, de toute évidence, décourage beaucoup de victimes potentielles. La pléthore d’acteurs impliqués (policiers, permanents associatifs, fonctionnaires de la préfecture…), qui tous partagent le même soupçon a priori sur l’authenticité des récits livrés par les prostituées, complexifie la procédure. Mon enquête montre surtout que la victime de la traite, décrite dans les rapports des organisations internationales et par les associations sous les traits d’une jeune femme naïve, innocente et vulnérable qui nécessite protection au nom de la défense des droits de l’homme, se métamorphose en « victime coupable » dès qu’elle endosse les habits de migrante sans papiers.
montre que la
victime de la traite
se métamorphose
en victime
coupable dès
qu’elle endosse les
habits de migrante
sans papiers.
À cet égard, la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 – récemment assouplie – avait été emblématique. Ce texte réintroduisait dans le Code pénal le délit de « racolage passif » au motif que poursuivre les prostituées pour ce délit permet non seulement de rétablir l’ordre public, mais aussi de démanteler les réseaux de proxénétisme par le biais de dépôt de plainte ou de témoignage, et de porter in fine assistance aux victimes de la traite. Mais, du coup, ces dernières ont endossé une double étiquette : celle de victimes (en raison des sévices qu’elles endurent) et celle de délinquantes (lorsqu’elles commettent des infractions pour racolage ou pour entrée irrégulière sur le territoire français). Ces femmes sont donc perçues à la fois comme objet de souillure et source de danger. Elles peuvent être reconnues comme des victimes du point de vue du droit, lors d’un procès, mais elles restent des suspectes à réprimer du point de vue des priorités nationales (protection de l’ordre public, contrôle de l’immigration et de l’exercice de la prostitution).
La loi de lutte contre le système prostitutionnel d’avril 2016 a supprimé le délit de racolage et pénalise les clients. Quelles réflexions vous inspire-t-elle ?
M. J. : L’abrogation du délit de racolage ne change rien à mes conclusions puisque le dispositif d’identification des victimes de la traite reste adossé à leur dépôt de plainte. Quant à la pénalisation des clients, cette disposition a été saluée par les associations féministes qui prônent l’abolition de la prostitution, et dénoncée par celles qui défendent le principe de la liberté de disposer de son corps. Le Syndicat du travail sexuel (Strass), en particulier, estime que cette mesure va obliger les personnes prostituées à prendre davantage de risques pour rencontrer des clients et les fragiliser un peu plus. La diabolisation du client, à mon sens, n’a aucun rapport avec les réalités du terrain. Certaines des victimes de la traite que j’ai rencontrées ont réussi à échapper aux griffes de leur souteneur grâce à l’aide d’un client devenu un amant. Cette loi reflète ce que la sociologue américaine Élisabeth Bernstein appelle « le féminisme carcéral », c’est-à-dire un féminisme qui recense ses victoires en comptabilisant non pas tant le nombre de femmes secourues que le nombre de personnes arrêtées (proxénètes et clients confondus).
- 1. Institut de sciences sociales du politique (Unité CNRS/Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense/ENS Cachan).
Voir aussi
Auteur
Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).
À lire / À voir

La Traite des êtres humains en France. De la victime idéale à la victime coupable, Milena Jakšić, CNRS Éditions, août 2016, 308 p., 25 €