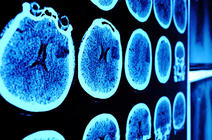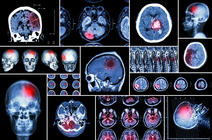Vous êtes ici
Bioéthique: faut-il repenser la filiation?
Les sondages montrent depuis plusieurs années une adhésion croissante des Français à l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes (célibataires ou en couple avec une autre femme), et à l’encadrement de la gestation pour autrui (GPA), actuellement strictement interdite en France1. Un récent sondage de l’Ifop, réalisé pour La Croix et le Forum européen de bioéthique, donne ainsi respectivement 60 % et 64 % d’opinions favorables à ces pratiques. Surtout, celles-ci existent déjà dans les faits et posent de nombreux problèmes juridiques, éthiques, sociaux, etc. La révision des lois de bioéthique, lors des États généraux de la bioéthique qui se tiennent du 18 janvier au 7 juillet 2018, ne pourra faire l’économie d’un débat sur ces questions. Un débat que notre récent rapport de recherche2 peut éclairer.
Dans notre rapport, nous étudions la filiation des enfants nés de Français qui recourent, à l’étranger, à la PMA ou à la GPA. Nous analysons l’expérience qu’ont les familles françaises ou binationales vivant en France et au Québec auprès des services de l’état civil et de la justice, les pratiques des juges en France et au Québec, ainsi que leurs conceptions de ce qu’est la famille et de ce que doit être leur rôle. Nous proposons également une analyse du droit et des décisions de justice en comparant quatre pays (France, Québec, Belgique, Espagne). En ressort une réflexion sur l’articulation du droit face aux transformations familiales contemporaines dans un contexte mondial complexe.



Une confusion entre procréation et filiation
Au terme de l’analyse comparative menée sur les dispositifs juridiques de reconnaissance de la famille lesboparentale, il ressort que la position de la France en matière de PMA est isolée par rapport aux trois autres pays étudiés, alors que tous s’inscrivent dans une tradition juridique plus ou moins commune. Le droit français se singularise ainsi par son attachement à une conception médicale de la PMA qui réserve ce traitement aux couples hétérosexuels stériles et en exclut les couples de femmes.
De plus, il n’admet pas encore, comme c’est le cas en Belgique, en Espagne et au Québec, qu’un enfant ait deux mères à sa naissance. La solution la plus fréquemment choisie par les couples de femmes pour fonder une famille est de recourir à un don de gamètes à l’étranger. Seule celle qui a porté l’enfant est alors considérée comme mère légale, l’autre devant adopter l’enfant avec le consentement de la première pour voir reconnaître sa maternité.
Il a fallu toutefois attendre l’avis de la Cour de cassation du 22 septembre 20143 pour que l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère devienne une solution acceptée par tous les tribunaux. En effet, jusqu’alors, un certain nombre d’entre eux considéraient que le recours à la PMA à l’étranger, en tant que contournement de la loi, pouvait faire obstacle au prononcé de l’adoption. Néanmoins, ce cas de figure reste un compromis, dans la mesure où l’établissement des deux liens de filiation maternelle ne peut s’effectuer par désignation directe et simultanée des deux femmes en tant que mères dans l’acte de naissance.
Les couples rencontrés dans cette étude nous ont confié les embûches qu’ils ont rencontrées sur leur parcours vers la reconnaissance de la filiation de leur enfant. Certaines familles ont reçu la visite de la brigade des mineurs et ont dû se soumettre à une enquête policière, d’autres ont vécu l’audience en vue de l’adoption comme une épreuve stressante et certaines ont craint de se voir refuser l’adoption, ce qui, exceptionnellement, s’est aussi avéré.
Quelle que soit leur conviction en matière de filiation homoparentale, plus des trois quarts des seize magistrats rencontrés constatent que la réforme initiée par la loi de mai 2013, qui ouvrait le mariage aux couples de même sexe, est inachevée. Soit parce que l’adoption de l’enfant de la conjointe ne leur semble pas la meilleure solution, soit que le maintien de l’interdiction pour les couples de femmes d’accéder à la PMA semble entretenir une grande ambiguïté quant à la légitimité des couples de même sexe à être parents d’un même enfant. Par ailleurs, lorsque le couple de femmes a eu recours à un homme de leur connaissance comme donneur de sperme, les juges paraissent embarrassés en ce qui concerne son rôle dans la vie de l’enfant : est-il simplement un donneur de sperme ou bien peut-il assurer au cours de la vie de l’enfant un quelconque rôle paternel ? Cet embarras s’avère éloquent quant à la relative confusion, couramment répandue, entre procréation et filiation.
Ordre public contre intérêt de l’enfant
Quant à la situation des enfants nés de français qui ont eu recours à une GPA pratiquée à l’étranger, par rapport à ces trois pays, le droit l’appréhende de façon beaucoup plus restrictive en France. Pourtant, comme la France, tous les pays envisagés considèrent que les conventions de GPA sont frappées de nullité parce qu’elles sont contre l’ordre public. Cela signifie que le contrat privé passé entre des parents d’intention et une femme qui porterait leur enfant ne peut pas être présenté devant un tribunal pour en forcer le respect. Ainsi, la femme porteuse ne peut exiger des parents d’intention qu’ils accueillent l’enfant et eux ne peuvent exiger qu’elle le leur remette et ce même si le contrat passé entre eux le stipulait. Pour la France, comme pour le Québec, l’Espagne et la Belgique, les conventions de GPA n’ont donc aucune valeur légale. Le Québec et l’Espagne interdisent le recours à la GPA. La Belgique n’a pas légiféré expressément sur cette question, mais les principes généraux du droit interdisent toute forme de commercialisation portant sur une personne, ce qui revient à considérer la convention de GPA comme contraire à l’ordre public. La GPA n’y est pas interdite sans pour autant y être encadrée légalement. En France, la GPA pratiquée dans le pays est passible de sanctions pénales, notamment pour ceux qui joueraient les intermédiaires entre les parents d’intention et la femme porteuse. Par ailleurs, en Espagne, au Québec et en Belgique, malgré le fait qu’on considère les conventions de GPA nulles et sans effet juridique, les juges appelés à se prononcer sur la filiation des enfants ainsi conçus ont donné priorité à l’intérêt de l’enfant et lui ont reconnu une filiation à l’égard des personnes qui ont souhaité sa venue au monde, plutôt qu’au respect de l’ordre public.

Ainsi, le débat existe aussi ailleurs qu’en France, entre l’intérêt de l’enfant qui commande de lui donner pour parents ceux qui ont souhaité sa venue au monde, et l’ordre public pour lequel seule la gestatrice est la mère de l’enfant et qui en France est interprété comme devant organiser la filiation juridique de manière à ce qu’elle mime la procréation. Mais les juges de ces pays ont trouvé moyen de rattacher l’enfant né d’une GPA à ses deux parents d’intention, alors qu’en France ils ont systématiquement dressé les barrières de l’ordre public ou de la fraude à la loi pour s’opposer à la reconnaissance de la filiation à l’égard des parents français. L’enfant dont la filiation n’était pas établie à l’égard de ses parents français, n’était pas considéré comme le fils ou la fille de ses parents, il n’était pas légalement rattaché à eux. Les parents n’avaient aucune responsabilité légale. En cas de décès, l’enfant ne pouvait légalement être confié à l’un ou à l’autre. Il n’héritait pas automatiquement de ses parents. La transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres français de l’état civil a été refusée jusqu’à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014, dans le désormais célèbre cas des jumelles Mennesson, pour atteinte à l’intérêt de l’enfant, privé d’identité familiale et de filiation paternelle avec son géniteur4.
Depuis cette condamnation sans ambiguïté de la France en 2014, la justice française a reconnu la paternité fondée sur un lien biologique, mais la question de l’officialisation de l’autre parent intentionnel est restée incertaine jusqu’aux arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 20175. Désormais, même si la voie de la reconnaissance directe de l’autre parent, conjoint ou conjointe du père légal (et biologique), demeure fermée, il est possible à ce second parent de demander au juge l’adoption de l’enfant. Cette adoption intraconjugaleFermerIl s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint ou de la conjointe. L’adoption intraconjugale est autorisée dans le cadre d’un couple marié. permettra ultérieurement de procurer un double lien de filiation à l’enfant à l’égard de ces deux parents d’accueil. Reste à voir si les juges penseront tous que l’adoption sollicitée est bien conforme à l’intérêt de l’enfant. Le droit français en laisse en effet l’appréciation au juge. Sans réforme claire du droit, il reste difficile de dire si ces adoptions seront aisément prononcées.
Un débat nécessaire sur le fond
À la lumière de cette recherche, quatre points nous semblent essentiels. D’abord, nous demandons que soit repensée et réorganisée la PMA en France de façon à ce que les couples de femmes et les femmes seules puissent accéder légalement à la PMA en France, tel que le recommandait d’ailleurs, en juin 2017, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE)6. Notre étude montre également qu’il conviendrait de mieux distinguer origines et filiation afin de lever la confusion entre la filiation instituée par le droit et les origines. Il n’est pas toujours très clair dans l’esprit de tous qu’il ne suffit pas d’avoir contribué à la conception d’un enfant pour en être un parent, ni qu’un donneur de sperme dont on connaîtrait l’identité n’est pas nécessairement un père potentiel. Des alternatives, existant dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Suède ou les Pays-Bas, sont possibles et permettraient aux personnes qui le souhaitent d’accéder, à leur majorité, aux données concernant l’identité de leurs donneurs de gamètes, tout en préservant le statut légal de leurs parents.
Il faut aussi permettre la transcription de la filiation des parents d’un enfant né de GPA, sans le détour de l’adoption, pour garantir la filiation avec les deux parents « intentionnels » d’un enfant né d’une GPA à l’étranger, dès lors que son acte de naissance a été légalement établi dans le pays de naissance de l’enfant. L’enfant entrerait alors véritablement du point de vue de l’état civil français dans chacune des lignées de ses propres parents et y acquerrait les droits et les devoirs afférents, sans avoir à détourner l’adoption de sa finalité (qui n’est pas d’adopter un enfant que l’on a contribué à faire naître) ni à traiter de manière différenciée le parent qui n’est pas le père biologique.
Enfin, il est temps d’ouvrir un débat serein sur la GPA. En France, le cadre réglementaire n’a pas été modifié depuis 1994 alors même que les pratiques de GPA transfrontières n’ont cessé de convoquer les juges et de mettre à dure épreuve la résistance de l’interdiction. Des confusions en découlent, des juges l’ont souvent répété au cours des entretiens réalisés, et l’analyse du droit présentée dans ce rapport l’illustre. L’efficacité des règles actuelles peut être questionnée. Si bien qu’une nouvelle discussion s’impose.
Il est légitime de se demander ce qu’implique le principe de l’indisponibilité du corps des femmes ou encore dans quelle mesure la GPA entraîne la marchandisation, et de s’inquiéter des éventuels rapports de pouvoir entre les demandeurs d’une GPA et la femme qui porte leur enfant. Il n’est pas moins légitime de se demander si la GPA n’est pas une autre façon de faire un enfant, sur la base d’un don d’une nature particulière et si elle n’exige pas, au minimum, de faire l’objet d’un encadrement spécifique à ce titre.
C’est un débat en cours au Québec. Même si cette évolution ne fait pas l’unanimité, l’interdiction de la GPA au nom de l’ordre public y est de plus en plus remise en question. Ce repli de l’ordre public en ce qui concerne la GPA est palpable en France, quoique beaucoup plus lent.
La maternité et la paternité, loin d’être seulement fondées en nature, font l’objet d’une convention sociale. Il revient à chaque société, à des moments réguliers de son histoire, de discuter des conditions auxquelles on peut devenir parent. Ce n’est pas tant la science qui a changé depuis la dernière révision des lois de bioéthique, mais la société. La nécessité même d’un droit de la famille illustre le fait que procréer un enfant ne suffit pas à en devenir le parent. Tout en prenant en compte à la fois l’importance croissante du désir et de la volonté dans la conception d’un enfant, explicitement exprimée par nos contemporains, l’évolution des techniques médicales au service de la procréation et les résistances qui s’expriment, il reste aujourd’hui à déterminer les conditions auxquelles on peut devenir parent en ce début de XXIe siècle.♦
Les points de vue, les opinions et les analyses publiés dans cette rubrique n’engagent que leur auteur. Ils ne sauraient constituer une quelconque position du CNRS.
- 1. Dans son avis n°129 de septembre 2018, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu un avis favorable à l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes (comme dans son précédent avis n°126 de juin 2017) et il reste positionné sur l'interdiction de la GPA.
- 2. « Le recours transnational à la reproduction assistée avec don. Perspective franco-québécoise et comparaison internationale », rapport publié en juillet 2017. Cette recherche a été réalisée avec le soutien de la Mission de recherche droit et justice, groupement d’intérêt public créé par le ministère de la Justice et le CNRS. Sur le site du rapport (http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/11/14-20-Rap...), vous trouverez le nom des autres chercheurs ayant participé à cette recherche.
- 3. Cass., avis, 22 septembre 2014 (no 14-70.006 et no 14-70.007).
- 4. CEDH 26 juin 2014, Mennesson c/France et Labassée c/France.
- 5. Civ. 1ère, 5 juillet 2017 (5 arrêts).
- 6. CCNE, avis n°126 (15 juin 2017) sur les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation.