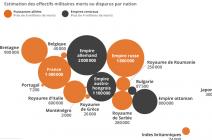Vous êtes ici
La Grande Guerre des animaux
Environ 10 millions d’équidés, 100 000 chiens, 200 000 pigeons : dans tous les camps, les animaux ont été enrôlés en masse dans la Grande Guerre pour porter, tracter, guetter, secourir, informer… Les tranchées ont également abrité des milliers de chiens et de chats apportés de l’arrière, de bestiaux abandonnés par des civils, d’animaux sauvages coincés au milieu du front, mais aussi des rats, des mouches, des poux et des puces attirés par l’aubaine. Parfois pourchassés, souvent gardés, voire choyés, ils ont fréquemment aidé les soldats à survivre dans l’enfer, à s’accrocher à la vie, à occuper leur temps, et les combattants de tous bords ont abondamment évoqué ces compagnons de guerre, souvent avec reconnaissance.
Les animaux, victimes oubliées de la guerre de 14-18
Nous sommes enclins à trouver cela surprenant, anachronique, certainement secondaire, anecdotique, mais c’est une erreur. Pour vaincre, les parties mobilisent toutes leurs forces et leurs ressources sans les cataloguer d’anciennes ou de nouvelles. D’autant que les hommes, les machines, les bêtes se complètent plus qu’ils ne se concurrencent, et que plus cette guerre dure, s’amplifie, exige, plus elle a besoin d’animaux. Son sort et celui des hommes sont étroitement liés à ces bêtes comme le déclare l’empereur Guillaume II lors d’un discours en août 1914 : « Nous allons nous défendre jusqu’au dernier souffle de nos hommes et de nos chevaux. »
on peut reconstituer le vécu des chevaux en tenant compte
de leur mode
de perception.
Pourtant, nous avons longtemps oublié ces animaux, notamment les historiens de la Grande Guerre, même ceux évoquant les combats, la violence, les souffrances. Cependant, des amateurs (au bon sens du terme) se sont intéressés à eux à partir des années 1970 et leur production littéraire croit depuis, illustrant un questionnement social croissant, renforcé par l’organisation d’expositions (Londres en 2005 ; Bruxelles en 2010), le succès de livres pour enfants (War Horse, Mopurgo, 1982), la sortie de films (Cheval de guerre, Spielberg, 2012).
Même s’ils insistent de plus en plus sur la condition de victimes, de héros oubliés de ces bêtes (en participant au phénomène social de victimisation des combattants, commun à toute l’Europe, commencé pour les hommes, prolongé ici aux animaux), ces amateurs gardent le point de vue des sources humaines disponibles, restent donc sur le versant humain et s’arrêtent aux utilisations humaines des animaux. Il en est de même des quelques historiens professionnels arrivés récemment au sujet, qui focalisent sur les utilisations et les représentations humaines.

Rendre aux animaux leur statut d’acteur
Mon approche est contraire : il s’agit de se déporter sur le versant animal, de centrer l’attention et la recherche sur les animaux de manière à retrouver leurs vécus, c’est-à-dire leurs actions, leurs émotions, leurs coopérations ou leurs résistances, leurs souffrances et leurs destins, de manière également à mieux comprendre les attitudes et les sentiments des soldats, à mieux expliquer leurs attitudes et donc les relations humano-animales. Il s’agit de construire une histoire animale donnant aux animaux un statut d’acteur agissant et influençant les hommes, leur octroyant une place centrale dans leur histoire.
Cela demande d’élargir la définition de l’histoire, en la faisant passer de science des hommes dans le temps à science des êtres vivants dans le temps. Cela demande aussi de recourir à d’autres sciences : l’écologie pour reconstituer les milieux et comprendre leur influence sur les comportements animaux, l’éthologie pour aborder ces comportements, les neurosciences à propos des capacités cognitives des animaux, la physiologie et la médecine vétérinaire pour leurs fonctionnements et leurs défaillances. Ces savoirs zoologiques servent à comprendre les témoignages, non pas des animaux, qui n’ont témoigné, par exemple en résistant ou en mourant, que d’une manière éphémère, mais ceux des combattants, des vétérinaires, des photographes, etc. Il peut sembler paradoxal de les utiliser pour retrouver les faits et gestes d’animaux, d’autant que les hommes ne s’intéressent qu’à quelques espèces et quelques aspects pour lesquels ils n’ont retenu que ce qu’ils pouvaient et voulaient voir, en déformant avec leurs imaginaires, leurs intérêts, leurs certitudes d’une espèce, d’une société, d’une époque. Mais ces problèmes se posent tout autant pour l’histoire humaine où l’on doit souvent passer par des intermédiaires, par exemple pour l’histoire des paysans, et toujours décrypter les grilles culturelles. Ici, la difficulté est plus grande mais pas radicalement différente.

Revisiter les documents historiques en changeant de point de vue
Ces documents doivent être « retournés » pour être bien déchiffrés du côté des animaux, en inversant la structure des récits, en retenant des détails mis au second plan, voire en lisant entre les lignes, et leurs informations doivent être croisées avec les savoirs des sciences zoologiques. Je dis croisées et non pas contrôlées, car cela supposerait que les combattants regardaient ou connaissaient moins bien les animaux que les savants actuels, ce qui est vrai pour des aspects, faux pour d’autres. Avec tout cela, il est possible d’appréhender les vécus des animaux en guerre, en prenant leur point de vue, d’abord géographique en se déportant vers eux, en se tenant à côté d’eux, mais aussi psychologique, si les documents le permettent, en essayant de ressentir comme eux. Ce n’est évidemment qu’une intention, une méthode, non une réalité, mais qui aide à se décentrer, ce que les éthologues commencent à faire, et ce que les ethnologues essaient de faire depuis longtemps. On peut ainsi suivre les itinéraires des bêtes, de leurs réquisitions à leurs morts ou leurs réformes, en passant par leurs apprentissages, leurs voyages jusqu’au front, leurs travaux, leurs peurs, leurs résistances ou leurs connivences, leurs fatigues, leurs souffrances, et ainsi mieux comprendre les relations avec les hommes.
Prenons l’exemple des charges de cavalerie sur lesquelles Français et Britanniques mettent une grande part de leurs espoirs, mais qui sont brisées, rendues inutiles par les mitrailleuses allemandes dès l’été 1914. Aucun texte n’évoque les ressentis des chevaux, mais certains retracent celui des cavaliers : le difficile contrôle du cheval, l’impossibilité de voir à cause de l’entassement et de la poussière soulevée, la confusion en raison des bruits, la peur… Céline, pourtant cuirassier aguerri depuis 1912, le dit bien : « Dans la lourde, ce n’était pas le cavalier qui comptait, mais le bourrin. C’est le cheval qui charge. Allez donc arrêter un cheval qui s’emballe, entraîné par les autres ! Et, à plus forte raison, lui faire faire demi-tour, si la peur vous prend au ventre ! Le bonhomme n’a plus qu’à s’efforcer de rester dessus et à donner de grands coups de sabre à droite et à gauche pour dégager ses abords. »

Tenir compte du mode de perception des animaux
À partir de ces témoignages, on peut reconstituer le vécu des chevaux en tenant compte de leur mode de perception. Ils ressentent de moins en moins le contrôle humain et gagnent une indépendance de mouvement qui pourrait les inciter à dévier à mesure qu’ils perçoivent des bruits, des cris, des odeurs suscitant leur peur, mais ils sont entravés par leur faible vision, restreinte aux flancs des voisins, aux croupes des prédécesseurs, au terrain juste devant, et par le fait qu’ils reçoivent encore plus de poussière dans les yeux et les naseaux alors qu’ils doivent de plus en plus se focaliser sur les obstacles multipliés à terre (corps d’hommes et de bêtes) pour les éviter. Les chevaux continuent donc à galoper sous l’effet du groupe, très important pour ces animaux grégaires, d’où la nécessité de charger serré afin d’éviter qu’ils prennent individuellement peur, s’arrêtent, retournent. Cette disposition est suicidaire face aux mitrailleuses, mais bel et bien obligée, et l’on voit à quel point les soldats dépendent des animaux.
Aussi ne peut-on bien comprendre la guerre si l’on ne regarde pas ce qui s’est passé de leur côté, si on n’essaie pas de restituer leurs vécus et leurs attitudes. Restons au cas des chevaux : ils stressent lors des réquisitions qui les projettent en des mondes inconnus, puis lors des voyages, entassés dans les cales et les wagons. Ils s’adaptent plus ou moins bien, du cheval de trait recevant une selle et un cavalier sur le dos au cheval de selle devant supporter des congénères dans un attelage. Ils s’effraient des détonations et de leur flash, des odeurs de sang et des phéromones de peur dégagés par les hommes et les bêtes. Ils s’épuisent à porter ou tirer, s’usent, s’anémient, subissent diverses épidémies, meurent en masse, jusqu’à 40 % côté français, un taux qui aurait tué 3,5 millions de poilus s’ils l’avaient subi ! Cela a de fortes conséquences sur la guerre, de l’incapacité des Français à repousser l’ennemi après la victoire de la Marne en 1914, en raison de l’épuisement des bêtes, ce qui condamne les belligérants à quatre ans de tranchées, à l’impossibilité des Allemands, désormais trop démunis en chevaux, à intensifier suffisamment leur offensive de la dernière chance au printemps 1918, ce qui les voue à la défaite.
À lire / À voir

Bêtes des tranchées. Des vécus oubliés, Éric Baratay, CNRS Éditions, octobre 2013, 256 p., 22 €

Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Éric Baratay, Seuil, coll. « L’univers historique », mars 2012, 400 p., 25,40 €