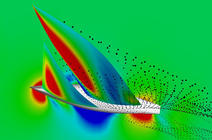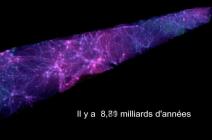Vous êtes ici
Interview de Michel Wieviorka : les sciences humaines et sociales à l'ère numérique

Vos recherches portent habituellement sur le racisme, le terrorisme, la violence… Or votre dernier livre, L’Impératif numérique, explore la montée en puissance des nouvelles technologies. Pourquoi cet intérêt pour le numérique ?
Michel Wieviorka : Les responsabilités que j’exerce à la tête de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) m’amènent à côtoyer des sociologues, des philosophes ou des linguistes qui sont plongés au cœur du numérique. Je rencontre également des bibliothécaires dont il bouleverse le travail, des éditeurs qu’il conduit à repenser leur modèle économique, des responsables de systèmes informatiques qui doivent remodeler leur offre en permanence… Le Collège d’études mondiales que j’ai créé en 2011 comporte par ailleurs deux chaires dédiées au développement des nouvelles technologies de l’information. C’est pour toutes ces raisons que le sociologue plutôt classique que je suis est véritablement entré dans l’ère du numérique, et que j’ai pris conscience tout à la fois des questions majeures que soulèvent ces technologies et des possibilités qu’elles ouvrent aux chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS).
Que peuvent apporter les Big Data, par exemple, aux SHS ?
M. W. : Ces énormes banques de données, dont les plus importantes ne sont pas consultables en open access (libre accès), offrent une masse d’informations fantastique dans quantité de domaines : politique, santé, histoire, littérature, consommation… Grâce à des outils dont la puissance croît exponentiellement, on peut connaître en quelques clics l’occurrence du mot « Dieu » dans l’œuvre de Proust et chercher toutes sortes de minuscules aiguilles dans d’énormes bottes de foin ! Les Big Data nous mettent aussi en face d’un formidable paradoxe : avec des données gigantesques, il devient possible de mieux comprendre et connaître l’expérience individuelle de chacun. Les Big Data induisent une autre manière de travailler, mais elles permettent, ou permettront bientôt, de prévoir des comportements d’achat, de calculer la probabilité pour une personne d’avoir ou de transmettre une maladie génétique, de connaître celle de conduite accidentelle pour des automobilistes, de récidive pour des criminels… Je vous en donne un exemple élémentaire : quand vous achetez un livre sur le site d’Amazon, on vous indique que vous auriez peut-être intérêt à acheter tel autre livre qui devrait vous intéresser. Cela va modifier toute notre vie collective, transformer par exemple le droit, mettre fin au voile d’ignorance qui permet de traiter les individus comme abstraitement égaux. Nous allons vers une individualisation qui doit beaucoup à ces immenses ensembles de données.
N’est-ce pas inquiétant ?
M. W. : De tels usages ont de quoi alarmer. De même, l’affaire Snowden, du nom de cet informaticien qui a révélé les pratiques de l’Administration américaine en matière d’espionnage, a mis en lumière les liens puissants qui existent aux États-Unis entre le pouvoir fédéral et les opérateurs du numérique (Google, Facebook…). Les Big Data ne sont pas Big Brother, mais la protection de données personnelles convoitées pour leur valeur marchande ou stratégique constitue un enjeu en termes de libertés. Dans ce contexte, le chercheur en SHS a toute légitimité à apporter des connaissances susceptibles d’éclairer le débat public et d’inspirer la décision politique. Encore faut-il qu’il ait accès aux données, et qu’il dispose des ressources pour les traiter.
La rupture numérique, par ailleurs, ne risque-t-elle pas de voir la sociologie tomber dans le quantitativisme ?
M. W. : Les milliards de données que génèrent les Big Data posent effectivement problème. Cette surabondance risque de susciter une sorte d’ivresse et une approche exagérément quantitative de questions historiques, sociologiques, anthropologiques, d’orienter la recherche vers un appauvrissement théorique. La technologie numérique facilite, prolonge, démultiplie la réflexion, mais elle ne peut pas la remplacer. Penser le contraire serait sacrifier la critique et la rigueur scientifique sur l’autel de l’informatique. Symétriquement, il est également possible que des chercheurs bien formés en SHS soient happés par les entreprises qui disposent de données, qu’ils y produisent des connaissances, un savoir renouvelé par de nouveaux paradigmes, par la définition de nouveaux objets, de nouveaux questionnements, au profit de ces entreprises et des pouvoirs politiques auxquels elles sont éventuellement liées.
facilite, prolonge, démultiplie
la réflexion,
mais elle ne peut pas la remplacer.
Quel genre de données, difficilement imaginables il y a quelques années, les réseaux sociaux sont-ils susceptibles de fournir aux SHS ?
M. W. : J’ai fait passer, fin 2012, une thèse sur les tueries scolaires aux États-Unis. Or la chercheuse, qui montre que les school shootings sont liés à l’individualisme moderne, a trouvé son corpus sur YouTube, où une partie non négligeable des gens qui s’expriment sur le sujet, et qu’elle appelle des « fans », affirment comprendre le geste des tueurs, et où les auteurs de ces crimes postent parfois des vidéos avant de passer à l’acte. Cette chercheuse, comme je lui ai fait remarquer amicalement lors de sa soutenance, aurait pu aller encore plus loin en entrant en contact avec les « fans », en débattant avec eux sur le Net pour tester ses conclusions et en proposant à certains d’entre eux de les rencontrer.
Au-delà de cet aspect instrumental, le monde virtuel en tant que tel peut-il constituer un terrain d’enquête fertile pour les SHS ?
M. W. : Bien sûr. Je pense notamment aux travaux de Dana Diminescu, qui dirige le programme TIC-Migrations de la FMSH. Cette sociologue est partie du constat que les migrants du XXIe siècle « sont connectés et se constituent en réseaux ». Elle a construit, avec une vaste équipe de chercheurs disséminés dans le monde, un atlas qui présente une par une les « e-diasporas » qu’elle a étudiées à partir des sites Web de chaque collectivité, ce qui éclaire d’un jour nouveau le phénomène migratoire. D’autres chercheurs, après la vague d’émeutes urbaines qu’a subie l’Angleterre en 2011, ont montré de leur côté que les réseaux sociaux et les systèmes de messagerie instantanée, loin d’aider les émeutiers à mieux s’organiser face à la police, comme l’ont prétendu à chaud la presse et le pouvoir politique, ont joué au contraire un rôle plutôt positif en limitant l’étendue et la durée des violences.
Le numérique offre-t-il aux SHS de nouvelles possibilités de convivialité intellectuelle ?
M. W. : Oui. Beaucoup de chercheurs en SHS mettent déjà en discussion leur travail sur Internet en envoyant, par exemple, un projet d’article à des collègues inscrits sur telle ou telle liste. Mais, au lieu de travailler entre pairs et experts d’une même niche, rien n’empêche de s’inscrire dans des réseaux ouverts, y compris au grand public. Un collègue historien a récemment trouvé par ce biais un manuscrit très précieux. Le chercheur ne doit donc pas se sentir menacé ou délégitimé par le fait que tout un chacun a accès à Internet. Pour autant, le dialogue d’égal à égal avec des internautes qui ne sont pas des chercheurs professionnels fait courir le risque d’un manque de rigueur scientifique ou d’une dilution de la réflexion, comme le soulignent ceux qui sont le plus hostiles à une telle démocratisation. Et il va sans dire que le terrain, même difficilement accessible, doit rester le fondement de la recherche en SHS.
Que propose aujourd’hui les grandes universités et organismes de recherche à de jeunes chercheurs en SHS désireux de se servir du numérique pour développer leurs projets ?
M. W. : Aux États-Unis, des universités ont créé de grands centres de digital humanities (humanités numériques) placés sous l’autorité d’un chercheur en SHS et fédérant des équipes de recherche pluridisciplinaires. En même temps, des réseaux comme la Modern Language Association, une très puissante société d’historiens de la littérature et de linguistes, soutiennent les chercheurs engagés dans ces centres pour la réalisation de projet. En France, les structures mises en place à partir de 2011 dans le cadre la Très grande infrastructure de recherche (TGIR) Huma-Num vont dans ce sens. Ces consortiums témoignent d’une conception renouvelée de la recherche, fondée sur des formes innovantes de collaboration entre laboratoires et destinée à faciliter le tournant numérique des SHS.
Voir aussi
Auteur
Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).
À lire / À voir

L’Impératif numérique, Michel Wieviorka, CNRS Éditions, coll. « Débats », 2013