Vous êtes ici
Les sciences du vivant ont besoin du genre
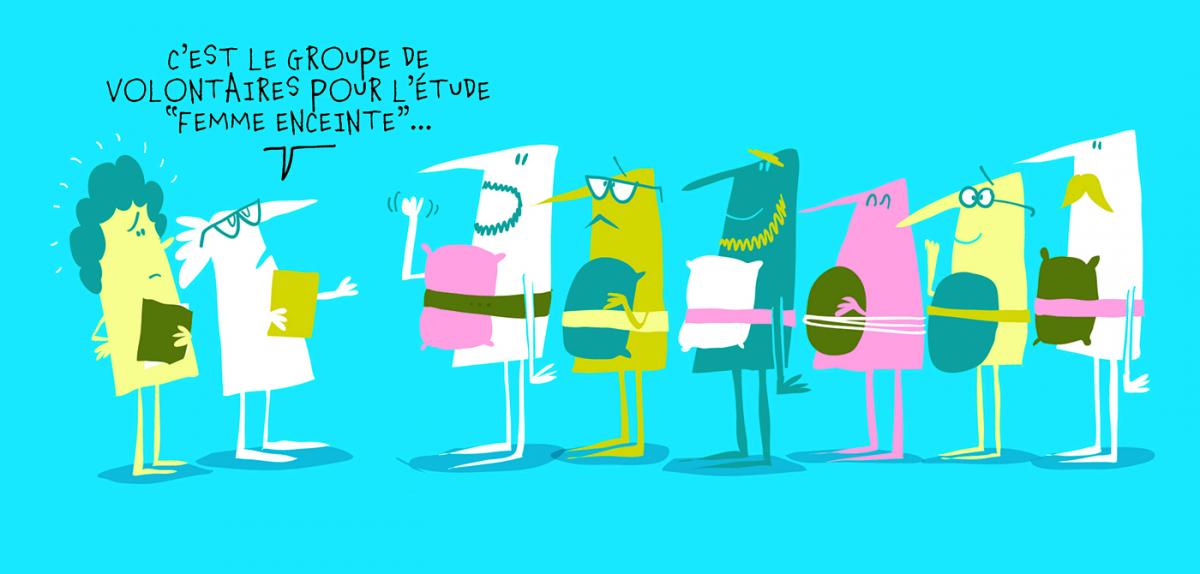
Autant, sous nos latitudes, les sciences humaines et sociales (SHS) intègrent depuis des années la notion de « genre », autant les sciences du vivant (SDV) condamnent encore ce concept à la portion congrue. Or « considérer sexe et genre dans la recherche n’a pas pour seul but d’obtenir une société plus égalitaire entre hommes et femmes, mais aussi d’obtenir une meilleure recherche scientifique », souligne Donna Mergler, professeur émérite de biologie à l’université du Québec, à Montréal. Encore faut-il d'abord s’entendre sur les mots. C’est que la plupart des biologistes, quand on leur dit « genreFermerLe genre, c'est ce que la société dicte comme relevant du féminin (le rose, les robes...) ou du masculin (le bleu, les jouets revolvers...). Tandis que les sexes sont définis par la biologie (chromosomes, hormones...). Les études de genre consistent notamment à décrypter les confusions entre sexe et genre. Par exemple, les filles ne sont pas biologiquement "prédestinées" à aimer le rose. Ce n'est qu'un stéréotype de genre, une construction sociale », comprennent « sexe ».
Or « sexe et genre ne sont pas des termes interchangeables, insiste pour sa part Françoise Moos, de l’Institut des neurosciences cellulaires et intégratives du CNRS et experte scientifique à la Mission pour la place des femmes de l’organisme. Le sexe est une qualité biologique, le genre un processus socioculturel », qui régit les divisions du pouvoir, du travail… au sein d’un groupe humain. Autrement dit, le sexe désigne l’ensemble des caractéristiques qui permettent la reproduction. Et le genre, le fait que les comportements des hommes et des femmes sont le résultat de processus sociaux. Les études de genre montrent notamment que ce que l'on pensait "naturel", lié au fait d'appartenir biologiquement à l'un ou l'autre des sexes, n'est parfois que pure construction sociale.
Voir cette vidéo : si les femmes sont plus petites que les hommes, ce n’est pas si « naturel » que cela...
Les femmes, oubliées des essais cliniques
Une recherche « genrée » en sciences biologiques doit, a minima, s’interroger sur l’incidence des différences de sexe biologique et l’influence du sexe social sur les expériences et les résultats. Pour les biologistes, la tentation est forte de ne choisir qu’un seul sexe comme modèle expérimental, en général le sexe masculin. Et ce pour une raison simple : le sexe mâle est considéré comme plus stable, car permettant de s’affranchir des problèmes liés aux variations cycliques des hormones sexuelles de la femelle. Pourquoi renoncer à ce choix si pratique ? Parce que les travaux ainsi effectués conduisent à extrapoler à l’ensemble de la population les conclusions propres à un seul sexe. Et à produire « une science éborgnée », selon l’expression de Donna Mergler. Généraliser aux deux sexes des mécanismes étudiés chez un seul, plaide Françoise Moos, « fausse les résultats de nombreux travaux et ne contribue pas à faire une science plus exacte et plus innovante », comme le montrent les expériences relatives aux maladies cardiovasculaires (MVC).
De fait, les femmes sont exclues de la plupart de ces essais, au prétexte que les MCV frappent en priorité les hommes1. Résultat, « les données obtenues chez les hommes sont transposées aux femmes alors que ces maladies, chez celles-ci, se présentent différemment, argumente Françoise Moos. Les symptômes, notamment, se manifestent sous la forme de mal de dos, de fatigue… Du coup, cela trompe souvent les médecins généralistes qui adressent des femmes proches de la crise cardiaque à un kiné ou un psy plutôt qu’à un cardiologue. Et cette prise en charge thérapeutique moins satisfaisante explique pourquoi les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité féminine en France avant le cancer ».
La sensibilité à la douleur s’avère un autre champ de recherche où scruter les interactions entre sexe et genre insuffle un « plus » indéniable. De fait, des facteurs non biologiques retentissent sur la tolérance à la douleur : par exemple, le niveau socioculturel ou l’appartenance ethnique. Mais les différences entre hommes et femmes, en la matière, ont aussi un fondement biologique lié, entre autres choses, aux hormones sexuelles. Et l’on constate des différences sexuées dans les types de pathologies douloureuses : la migraine touche plus les femmes, la goutte davantage les hommes.
Le stress, les hormones et l’éducation
Même chose au sujet des maladies liées au stress, dont certaines ont une plus forte prévalence chez les femmes (dépression, anxiété…), tandis que d’autres s’avèrent plus fréquentes chez les hommes (affections coronariennes, addictions…). Là encore, « des facteurs biologiques et sociaux interagissent pour expliquer ces différences, intervient la neurobiologiste Marie-Pierre Moisan, du laboratoire Nutrition et neurobiologie intégrée, à Bordeaux, qui a montré l'influence du genre sur le stress et l'obésité des femmes en prison. Côté biologie, la principale hormone du stress (le cortisol) est augmentée par les œstrogènes (principales hormones sexuelles féminines) et diminuée par la testostérone (principale hormone sexuelle masculine) ». Mais l’éducation intervient elle aussi dans la réactivité au stress. Une étude menée par Laura Stroud, de l’université Brown, aux États-Unis, montre ainsi que les hommes, souvent conditionnés à réussir professionnellement, sont plus sensibles à un stress faisant intervenir la performance au travail, alors que les femmes, dont la formation insiste davantage sur la valeur d’entraide, sont plus sensibles au rejet social.

l’expérimentateur
influe sur les
résultats des
études biologiques
réalisées sur
les animaux.
Plus surprenant : les chercheurs en sciences du vivant auraient tout intérêt à faire cas du sexe biologique et de l’environnement « social » des animaux gardés en animalerie. Comment ? En s’attardant sur quelques points clés. Une expérience fait-elle appel à des mâles ou à des femelles ? Les animaux sont-ils opérés, auquel cas ils émettent des signaux chimiques de souffrance qui modifient l’état basal (c’est-à-dire en l’absence de stress) des autres animaux ? Quid des odeurs, du niveau sonore ?, etc. « Ces paramètres ne figurent jamais dans les publications bien qu’ils aient un impact sur les variables biologiques que l’on mesure », déplore Françoise Moos, avant de rappeler que le sexe de l’expérimentateur, que perçoivent les animaux, interfère également dans les résultats des tests et leur analyse2. Et que les cellules cultivées in vitro possèdent elles aussi un sexe et, selon qu’elles ont été prélevées sur des organismes mâles ou femelles, réagissent différemment aux produits pharmacologiques qu’on leur applique.
Les filles surexposées au tabagisme parental
Comme les biologistes, les chercheurs en santé-environnement s’intéressant notamment à la neurotoxicité des polluants gagneraient à recourir plus souvent aux concepts de sexe et de genre. Dès le début du XXe siècle, ce type d’outils a permis de mieux comprendre et pouvoir agir sur les relations complexes qui gouvernent les rapports entre l’environnement et la santé humaine. Dans les années 1920-1930, des recherches ont par exemple montré que, dans l’industrie américaine, les femmes présentaient un taux de plomb dans le sang supérieur à celui des hommes. Et que cette différence provenait non pas d’une plus grande « susceptibilité » des femmes à ce métal, comme le pensaient les médecins de l’époque, mais du fait qu’elles occupaient des emplois sous-qualifiés qui les obligeaient à inhaler de grandes quantités de poussières de plomb.
« Il est intéressant de faire le lien entre ces études d’il y a presque cent ans et celles qui, aujourd’hui, permettent de mettre en lien l’exposition des femmes aux substances chimiques dans plusieurs industries et le cancer du sein », commente Donna Mergler. D’autres enquêtes, telles celles conduites en 2008 par Sam Pattenden, de la London School of Hygiene and Tropical Medecine, mettent en évidence que, si les filles sont plus sensibles que les garçons aux effets du tabagisme parental, ce n’est pas dû à une prédisposition biologique. Mais parce qu’elles restent plus confinées à la maison, où la pollution de l’air est plus forte. Un effet clairement imputable au genre, donc…
- 1. Les données statistiques indiquent le contraire : plus de femmes meurent de MCV entre 30 et 75 ans (Source : M.-J. Saurel-Cubizolles et al., « Social inequalities in mortality by cause among men and women in France », J Epidemiol Community Health., mars 2009).
- 2. « Olfactory exposure to males, including men, causes stress and related analgesia in rodents », Nature Methods, publié en ligne le 28 avril 2014.
Voir aussi
Coulisses
Aux États-Unis et en Europe du Nord « le binôme sciences du vivant-genre est mis à contribution dans de multiples domaines, ce qui explique que les publications internationales sur le genre en clinique, en santé et en biologie émanent pour l’instant de pays étrangers », commente Anne-Marie Devreux, du Cresppa, coresponsable scientifique du Défi Genre lancé par la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS en 2012.
Auteur
Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).




























