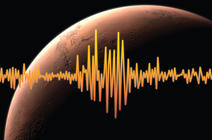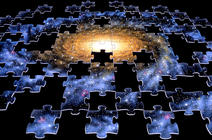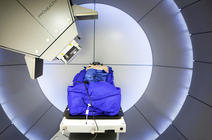Vous êtes ici
68, année historique

Expositions, films, livres, colloques… La France célèbre avec éclat le cinquantenaire du mouvement de contestation qui a ébranlé l’Hexagone en 1968. Comment s’explique une telle ferveur ?
Michelle Zancarini-Fournel1 : Le « moment 68 » a marqué en profondeur notre histoire récente et notre mémoire nationale. Si l’on en croit les sondages, les Français classent l’événement comme le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette perception tient sans doute au bouleversement temporaire du quotidien, de l’ordre social et politique qu’il a provoqué. De fait, on a assisté sur tout le territoire à un arrêt des activités ordinaires, à une contestation de l’autorité dans les universités, l’administration, les entreprises, les familles…, à une revendication d’égalité ainsi qu’à une prise de parole généralisée qui a participé au décloisonnement de l’espace social et suscité des rencontres improbables entre ouvriers, paysans, employés, cadres et étudiants. Tout cela justifie l’intensité du souvenir que le mouvement a laissé sur les acteurs et les spectateurs.
On parle très souvent de « mai 1968 », voire de « Mai » tout court. Pourquoi n’aimez-vous pas cette dénomination ?
M. Z.-F. : Parce que cette contraction, qui s’est fixée dans la mémoire commune et qui a été confortée par les commémorations décennales de l’événement, engendre un effet trompeur de réduction temporelle (comme si tout s’était passé en un mois) et géographique (comme si Paris avait été l’unique décor du mouvement). Elle enferme le passé dans un cadre chronologique et spatial trop restreint, de l’entrée de la police dans la cour de l’université parisienne de la Sorbonne, le 3 mai, au retour à l’ordre, après le discours à la radio du président de la République, le général de Gaulle, le 30 mai. De même, on présente souvent la chronologie des événements selon une division ternaire : une crise étudiante (du 3 au 13 mai) marquée par des manifestations, puis une crise sociale (entre le 13 et le 27 mai) avec la plus grande grève générale du XXe siècle (sept millions de grévistes salariés), et enfin une crise politique (du 27 mai au 30 juin) qui se terminerait par le discours du général de Gaulle annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections. En réalité, il convient de distinguer quatre moments qui se juxtaposent : 1/ la révolte étudiante et lycéenne (du 3 au 11 mai) ; 2/ la grève et l’occupation des facultés, des lycées et des entreprises (du 13 mai jusqu’à fin juin) ; 3/ la crise politique (du 24 au 30 mai) autour d’un syndrome de guerre civile et de division de la nation ; 4/ la constitution d’un compromis républicain avec la campagne électorale, parallèlement à l’arrêt très progressif des grèves et des occupations (au mois de juin).



1968 constitue-t-il une rupture brutale dans l’histoire sociale, politique et culturelle de la France ?
M. Z.-F. : Non. Les indices d’un malaise sont clairement perceptibles bien avant les événements. La contestation étudiante, par exemple, fermente depuis 1963. À Strasbourg, après une longue grève des étudiants dont les revendications portent notamment sur la fin des examens, la suppression des notes, l’établissement d’un contrôle continu, un professeur propose de mettre l’Institut de sociologie en autogestion. Les situationnistes (militants contre le capitalisme et la société du spectacle), à la tête des organisations étudiantes strasbourgeoises, publient des analyses percutantes sur la situation internationale et contre la société de consommation. Au début de l’année 1968, par ailleurs, la police est entrée dans plusieurs facultés (Caen, Nantes, Toulouse…), souvent à la suite de manifestations pour la libre circulation des filles et des garçons dans les cités universitaires. Les rapports des préfets sur les manifestations violentes de paysans, d’ouvriers et de lycéens en 1967-1968 parlent quant à eux de « répétition générale », d’incidents précurseurs et de bouleversements à venir. Bref, la séquence mai-juin 68 n’éclate pas en France comme un orage dans un ciel d’azur même si l’occupation, le 22 mars, du bâtiment administratif de la faculté de Nanterre par près de 150 étudiants menés par Daniel Cohn-Bendit, a été érigée après coup en détonateur de la révolte.
À la même époque, des mouvements comparables bousculent-ils d’autres pays ?
M. Z.-F. : Le mouvement français n’est pas isolé. Les autres pays européens, les États-Unis, le Japon, le Sénégal ou la Tunisie sont eux aussi traversés par des vagues de contestation. Les étudiants y sont partout actifs et parfois violents, à l’instar des Zengakuren au Japon qui rejettent tout à la fois le communisme, chinois comme russe, et le capitalisme américain. Le phénomène touche à l’occasion d’autres groupes sociaux : ouvriers en Italie et en Espagne (comme en France), intellectuels et ouvriers à Prague et à Varsovie, Noirs aux États-Unis… Les principales caractéristiques de cette révolte planétaire sont la diffusion d’une contre-culture littéraire et musicale propre à une classe d’âge, la jeunesse, et l’adoption de nouvelles pratiques d’intervention (comme les sit-in des étudiants et des Noirs américains) qui sont diffusées largement dans les magazines télévisés.
Revenons au cas français. Peut-on comparer la crise ouverte en 68 avec la révolution de 1789 ?
M. Z.-F. : Certains l’ont fait, comme l’historien Michel de Certeau dans son livre La Prise de parole : « On a pris la parole comme on a pris la Bastille. » Le sociologue Edgar Morin, dans La Commune étudiante, suggère pour sa part « une sorte de 1789 socio-juvénile » qui rapproche les catégories sociales (étudiants, ouvriers, jeunes déclassés, exilés ou exclus). Il évoque également la Commune de Paris de 1871, 1905 et le cuirassé Potemkine, 1917 et le croiseur Aurora, 1918 et la révolte spartakiste, le Front populaire et la guerre d’Espagne en 1936. Cependant, si on évoque ce passé en 1968, et si la barricade relève d’une longue tradition insurrectionnelle, le langage et les revendications sont autres : l’usage du passé passe par son utilisation et sa réinterprétation dans le présent.
Quel est le bilan des modifications produites par les événements de 68 ?
M. Z.-F. : D’abord, contrairement à ce que proclame la vulgate, on ne peut pas parler d’« accords de Grenelle » puisque le protocole signé le 27 mai au matin entre l’État et les représentants syndicaux au ministère du Travail, rue de Grenelle, a été rejeté par les salariés. En revanche, des augmentations de salaires conséquentes ont été obtenues, et une loi légalisant la section syndicale d’entreprise a été adoptée en décembre 1968. En novembre, la loi Edgar Faure a acté « la mort de l’université française », selon la formule percutante de l’historien Antoine Prost, et la naissance d’un nouveau système universitaire. En avril 1969, la démission du général de Gaulle a été un prolongement indirect du bouleversement du pays. Et des « répliques » du séisme se sont fait sentir dans la société française tout au long des années suivantes sous la forme de contestations aussi diverses que vivaces.
Cinquante ans après les soubresauts de mai-juin 68, qu’en reste-t-il, selon vous ?
M. Z.-F. : Même s’il est refoulé, dénié ou refusé, il y a héritage, de fait. Le meilleur exemple, fondamental, est la victoire des féministes qui ont obtenu par leurs combats l’élaboration et la promulgation des lois Veil de 1974 (remboursement de la contraception) et 1975 (légalisation de l’interruption volontaire de grossesse). Ces lois ont changé radicalement la vie de toutes les femmes. Les familles, elles, ont été bouleversées par la cohabitation avant le mariage, les naissances hors mariage et l’augmentation des divorces après la loi de 1975, qui scelle la séparation entre conjugalité et parentalité. 68 a eu aussi pour conséquence, après les grèves d’OS (ouvriers spécialisés) de 1971-1973 entre autres dans l’industrie automobile, l’adaptation du capitalisme. Ce dernier s’est transformé de fond en comble au prix d’un chômage de masse qui a contribué à creuser plus encore les inégalités sociales. Enfin, la volonté de « changer la vie », récupérée par les partis politiques de gauche, a conduit à l’alternance politique en 1981.
Un nouveau Mai 68 peut-il se produire ?
M. Z.-F. : Le fantôme de 1968 hante la société française depuis des décennies. Chaque conflit social d’une certaine ampleur, quel que soit son objet, offre l’occasion de se remémorer les événements de 68. Cela a été le cas lors des manifestations contre le Contrat d’insertion professionnelle (CIP) en 1986 (mobilisation d’étudiants), contre le Smic jeunes en 1994 (lycéens et étudiants), contre le plan de réforme des systèmes d’assurance maladie, d’assurance chômage et des retraites en novembre-décembre 1995 (salariés du public) ou contre le Contrat première embauche (CPE) au printemps 2006 (étudiants). De même, les épisodes de rébellions urbaines de l’automne 2005 ont été vus comme « un petit Mai 68 des banlieues », même si cette analyse est discutable. Quant à prédire l’avenir, ce n’est pas dans mes compétences d’historienne.
Le vent de liberté qui a soufflé lors des « printemps arabes » et des mouvements d’occupation des places présente-t-il des analogies avec 68 ?
M. Z.-F. : Des grandes villes occidentales au monde arabe, en passant par l’Ukraine et le Brésil, des mouvements de contestation ont éclos au début du XXIe siècle sur les places publiques, surtout après la crise de 2008 et son cortège de conséquences funestes (accroissement de la précarité, du chômage et de la paupérisation). Ces mouvements collectifs présentent la même particularité qu’en 1968 : ils interpellent les pouvoirs en place en occupant la rue et revendiquent une démocratie directe. À plus ou moins brève échéance, les régimes autoritaires les ont réprimés. En Égypte et en Tunisie, les plus actifs sont poursuivis, persécutés, arrêtés, parfois assassinés. Mais on ne peut évaluer quels espoirs ont été semés.
À LIRE
- 68, une histoire collective, Philippe Artières et Michelle Zancarini-Fournel (dir.), La Découverte, coll. « Cahiers libres », mai 2018 (2008), 880 p., 29 €
- Le moment 68. Une histoire contestée, Michelle Zancarini-Fournel, Seuil, avril 2008, 320 p., 22,30 €
- Le Mai 68 des écrivains. Crise politique et avant-gardes litteraires, Boris Gobille, CNRS Éditions, coll. « Culture et société », janvier 2018, 400 p., 25 €
- 68. Les archives du pouvoir. Chroniques inédites d'un État face à la crise, Philippe Artières et Emmanuelle Giry (dir.). Archives nationales/L’Iconoclaste, avril 2018, 304 p., 25 €
- 1. Professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université Claude Bernard Lyon-1, membre du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (CNRS/Univ. Lumière Lyon 2/Univ. Jean-Moulin Lyon 3/Univ. Grenoble-Alpes/ENS Lyon).
Voir aussi
Auteur
Philippe Testard-Vaillant est journaliste. Il vit et travaille dans le Sud-Est de la France. Il est également auteur et coauteur de plusieurs ouvrages, dont Le Guide du Paris savant (éd. Belin), et Mon corps, la première merveille du monde (éd. JC Lattès).