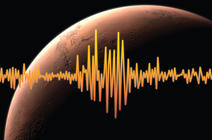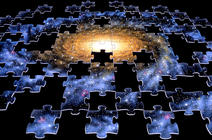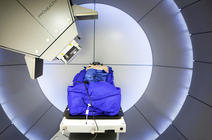Vous êtes ici
Les migrations à rebours des idées reçues

Vous êtes démographe, vous dirigez l'Institut Convergences Migrations1, et vous avez passé la majeure partie de votre carrière entre l’Institut national d’études démographiques (Ined) et l’Insee. Depuis quand travaillez-vous sur le sujet des migrations ?
François Héran : J’ai découvert le sujet des migrations en 1976. Après des études de philosophie, j’ai fait une thèse d’anthropologie sur les transformations de la grande propriété agraire en Andalousie depuis le XVIIIe siècle, ce qui m’a amené à m’intéresser aussi aux micropropriétaires qui vivaient en marge du système et qui, à cette époque, étaient nombreux à émigrer. J’ai étudié surtout les facteurs qui poussaient à l’émigration les habitants de huit villages de montagne, dans l’arrière-pays de la Costa del Sol. Ce que j’ai découvert m’a surpris : les plus pauvres, les analphabètes, les chargés de famille, migraient peu ou seulement au sein de la région ; c’étaient les plus instruits, les plus jeunes…, qui migraient au loin, vers la France ou l’Allemagne.
À l’époque, peu de travaux existaient sur la migration, et les grands sociologues français comme Pierre Bourdieu, Raymond Boudon ou Alain Touraine ne l’abordaient guère, si ce n’est parfois à travers le prisme de la pauvreté. On ne parlait d’ailleurs pas d’immigrés mais d’étrangers.
C’est seulement à partir de 1993, quand j’ai pris la tête de la division des Enquêtes et des études démographiques de l’Insee, que j’ai retrouvé le sujet des migrations, que je n’ai plus quitté depuis : mon équipe élaborait les grands indices démographiques de la France et notamment le solde migratoire. Notre travail n’était pas simple à l’époque. C’était juste après la chute du Mur de Berlin (novembre 1989, NDLR), et des rumeurs persistantes annonçaient l’arrivée massive de migrants depuis l’Est de l’Europe. Pourtant, on avait beau scruter les indicateurs, on ne voyait rien venir. Pour la première fois, j’ai touché du doigt le décalage qui pouvait exister entre les craintes sur les migrations et la réalité statistique.



Vous évoquez le décalage qui existe entre la perception que l’on peut avoir des mouvements migratoires et la réalité des chiffres. Que nous disent aujourd’hui les statistiques sur le phénomène des migrations dans le monde ?
F. H. : J’aimerais rappeler ici la définition de l’immigré retenue par l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou encore la Banque mondiale, qui produisent ces recensements internationaux : les immigrés qu’un pays enregistre sur son sol à un moment donné sont « les personnes nées étrangères à l’étranger, qui ont passé la frontière dans l’intention de s’installer dans le pays hôte pour une durée d’au moins un an ». La seconde génération, née sur le sol du pays hôte, n’est pas elle-même immigrée selon cette définition. Les immigrés naturalisés, en revanche, restent des immigrés aux yeux des statisticiens.
Selon les derniers chiffres disponibles, on dénombre aujourd’hui près de 260 millions de migrants dans le monde. C’est 100 millions de plus qu’en 1990, mais il faut se souvenir que la population mondiale n’a cessé de croître sur cette période… En proportion, les immigrés représentaient 2,9 % de la population mondiale en 1990. Ils sont aujourd’hui 3,4 %, ce qui est peu. On peut majorer ce chiffre à 4 % pour tenir compte de la migration non déclarée. Cela veut dire que plus de 95 % de la population mondiale n’a pas bougé. On est donc loin du raz de marée décrit par certains.
De même, l’idée selon laquelle ce sont les pauvres des pays du Sud qui fuient vers les pays riches du Nord serait à nuancer fortement…
F. H. : La fameuse phrase de Michel Rocard prononcée en 1989 selon laquelle « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » continue de sonner comme un slogan, mais elle ne décrit pas la réalité. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les populations des pays les plus pauvres, ceux où l’on gagne en moyenne moins de 1005 dollars par an et par personne, qui migrent le plus. Car pour migrer, il faut un minimum de moyens. Ce sont les pays aux revenus « moyens faibles » ou « moyens élevés », selon les catégories de la Banque mondiale, qui migrent le plus, soit entre eux, soit vers les pays aux revenus « élevés » affichant en moyenne 12 000 dollars de revenus annuels par personne. Au final, on a relativement peu de migration directe des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. La métaphore mécanique, qui voudrait que les flux de migrants s’écoulent des contrées pauvres vers les contrées riches, ou des espaces surpeuplés vers les espaces sous-peuplés, ne décrit aucunement la réalité.

Quels sont les principaux couloirs migratoires dans le monde aujourd’hui ?
F. H. : Le plus important, de loin, est celui qui va du Mexique aux États-Unis : 12 millions d’immigrés mexicains sont aujourd’hui présents sur le sol états-unien. Les États-Unis restent le pays le plus attractif au monde. Ils accueillent également des diasporas considérables de Chinois, Philippins, Indiens ou Portoricains.
Autres grands couloirs, celui qui relie le Bangladesh à l’Inde, soit 3,3 millions de personnes, ou encore celui qui va de la Turquie vers l’Allemagne et concerne 2,7 millions de personnes. En Asie, celui qui relie l’Inde aux Émirats arabes unis représente 2,2 millions de personnes et celui qui va de l’Afghanistan vers l’Iran 1,7 million de personnes. L’Afrique n’a qu’un seul grand couloir migratoire : c’est celui qui mène du Burkina Faso à la Côte d’Ivoire, avec 1,3 million de personnes. Et, contrairement aux autres continents, l’Afrique subsaharienne migre assez peu en dehors du continent africain : 75 % de la migration subsaharienne reste cantonnée à la zone Afrique, tandis que 16 % de cette migration seulement est recensée en Europe.
Quelle est la situation migratoire en France ?
F. H. : La France est une terre d’immigration depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, ce qui fait de nous une exception au sein de l’Europe. Au XIXesiècle, en effet, les autres pays européens étaient tous des terres d’émigration, vers le Nouveau Monde notamment. Les Belges ou les Italiens au XIXe siècle, suivis des Polonais à partir des années 1930, des Espagnols, puis des Marocains et des Algériens dès les années 1950 sont venus travailler dans nos fermes, nos usines, nos mines… Depuis la crise pétrolière et l’interdiction en 1974 de la migration de travail dans notre pays (sauf dérogation), nous ne recevons plus désormais qu’une migration alimentée par les droits de l’homme. Elle est liée aux différentes conventions internationales que nous avons signées, comme la Convention européenne des droits de l’homme, qui établit qu’un immigré a le droit d’avoir sa famille auprès de lui, ou la Convention de Genève sur le droit d’asile. En France, moins de 10 % des titres de séjour sont délivrés chaque année pour le motif du travail (soit 20 000 titres en moyenne). Le reste se répartit entre les étudiants (90 000 par an), le regroupement familial et le mariage d’un Français avec un non-national (90 000 par an), et enfin les personnes accueillies pour des raisons humanitaires (moins de 20 000 par an avant la crise ouverte en 2015). À noter que ces chiffres sont restés stables depuis le début des années 2000, contrairement à l’Allemagne, par exemple, où chaque crise migratoire – les guerres de l’ex-Yougoslavie, le conflit du Kosovo, le conflit syrien… -, provoque une affluence spectaculaire de migrants que les Allemands s’efforcent d’accueillir.

Depuis plusieurs années, certains représentants politiques français réclament la mise en œuvre, comme cela se fait au Canada, d’une politique de quotas et d’une immigration « choisie ». Est-ce réalisable dans notre pays ?
F. H. : Contrairement à la France, le Canada accueille une importante migration de travail : 28 % des titres de séjour sont attribués au titre du travail, auxquels s’ajoutent 34 % de titres attribués d’emblée aux conjoints et aux enfants – soit 62 % de tous les titres de séjour accordés. Si le Canada sélectionne en effet les personnes qu’il accueille au titre du travail, c’est sur une liste de critères (niveau de langue, niveau d’études, type d’emploi recherché…) qui ne tient pas compte du pays d’origine. Les Canadiens ne parlent d’ailleurs pas de « quotas » mais d’« objectifs » à atteindre, fixés à des niveaux très élevés : 300 000 entrées par an, en moyenne. Rien à voir avec l’idée de quotas agitée par certains parlementaires français, qui y voient tout au contraire un plafond à fixer au plus bas. C’est un paradoxe : les Canadiens sélectionnent fortement la migration de travail, mais pour en accueillir cinq à six fois plus que nous, compte tenu des différences de population.
Revenons sur l’accueil des réfugiés, qui divise l’Europe depuis 2015 et le début de la « crise migratoire ». Quel en est le bilan en Europe, et en France en particulier ?
F. H. : Si l’on cumule les trois années 2015-2016-2017, l’Union européenne a accordé le statut de réfugiés à un million de demandeurs d’asile. Les deux pays qui ont accordé le plus de statuts de réfugiés relativement à la taille de leur population sont la Suède (4 580 protections accordées pour 1 million d’habitants), et l’Allemagne (3 740 protections pour 1 million d’habitants), la moyenne européenne s’établissant à 1 030 statuts de réfugiés accordés pour 1 million d’habitants. La France, pour sa part, s’est contentée d’accorder 510 protections pour 1 million d’habitants, ce qui nous place au 17e rang européen. Peut-être avons-nous été moins sollicités que d’autres pays, me direz-vous… Pour le savoir, il faut regarder le taux d’acceptation des demandes d’asile en Europe sur ces trois années. Il s’établit à 53 % en moyenne pour l’ensemble de l’Europe, le maximum étant atteint par les Pays-Bas (68 %) et le minimum par la Pologne (13 %). La France n’a accepté pour sa part que 25 % des demandes d’asile déposées, ce qui nous place au 27e rang européen. Certes, les Syriens représentaient seulement 4 % des demandeurs d’asile en France, contre 33 % en Allemagne, mais cette différence ne suffit pas à expliquer une position aussi basse dans le classement.



On le comprend, le sujet des migrations est plein de nuances et supporte mal les généralisations. Quel est selon vous le rôle de la recherche sur ces questions ?
F. H. : Le niveau de connaissance de la société est très faible sur les questions migratoires. Peu de nos concitoyens et de nos politiques savent par exemple que la France, proportionnellement à sa population, accueille finalement très peu de demandeurs d’asile. Les taux d’acceptation sont pourtant tirés des données d’Eurostat, établies grâce aux chiffres communiqués officiellement par chaque pays ! Les chercheurs doivent unir leurs efforts pour établir les faits, en croisant leurs points de vue, qu’ils soient géographes, sociologues, historiens, économistes, spécialistes en santé publique… C’est l’objectif de l’Institut Convergences Migrations que je dirige depuis sa création, fin 2017, et qui fédère 280 chercheurs issus de 120 laboratoires différents. Nous échangeons d’ailleurs régulièrement avec les journalistes qui sont des maillons essentiels de cette diffusion de la connaissance. Nous venons également d’ouvrir un nouvel espace sur notre site, baptisé De facto, sur lequel nous publions désormais chaque mois des données destinées au grand public.
La toute première série de données, publiée en novembre 2018 sur De Facto, est consacrée au thème très sensible du retour dans le pays d’origine. On y apprend que plus on ferme les frontières, plus le taux de retour des migrants diminue…
F. H. : C’est ce qui se passe depuis que l’on a arrêté la migration de travail, en 1974. Les migrants qui faisaient des allers-retours avec leur pays d’origine ont eu peur de ne plus pouvoir revenir en France et ont commencé à faire venir leur famille. Le regroupement familial s’est consolidé et a fixé ces immigrés sur notre sol. L’idée de « l’appel d’air » créé par une politique de visas trop généreuse se révèle donc fausse : la fermeture des frontières accroît le nombre des immigrés au lieu de le réduire. Cela a été confirmé il y a peu par la grande enquête européenne « Migrations entre l’Afrique et l’Europe », menée à la fois dans les pays de départ et dans les pays d’arrivée. Les chercheurs y montrent clairement que le taux de retour en Afrique des Africains a diminué depuis que l’on a réduit le nombre des visas.
Vous souhaitez, avec d’autres, la création d’un Giec des migrations. Une première réunion de travail est d’ailleurs organisée ce lundi 10 décembre à Paris. De quoi s’agit-il plus précisément ?
F. H. : Ce sont trois chercheuses, Virginie Guiraudon2, Hélène Thiollet3 et Camille Schmoll4, qui sont à l’origine de cet appel relayé par l’Institut Convergences Migrations et signé par 800 spécialistes du domaine. L’idée est de constituer un groupe d’experts européen et on l’espère, à terme, mondial, sur la question des migrations et de l’asile. Vu la complexité des questions migratoires et la diversité des situations d’un pays à l’autre, nous pensons qu’il est nécessaire de créer un réseau de référence fort au niveau européen, pour répondre à des questions simples. Par exemple, quel est le bilan de l’accueil des demandeurs d’asile en Europe ? Quel est le bilan de l’intégration des immigrés et comment mesurer celle-ci efficacement ? Que peut-on faire pour combler nos lacunes sur la mesure des migrations irrégulières ou sur leur ampleur. Nous voulons également étudier la possibilité de lancer des expérimentations, notamment sur l’effet d’une politique de visas circulants, facilitant les allers-retours entre pays d’accueil et pays d’origine. Le défi est immense, car la politique migratoire relève encore de la souveraineté des États. ♦
- 1. L’Institut Convergences Migrations, créé fin 2017, fédère 280 chercheurs issus de 120 laboratoires. http://icmigrations.fr/
- 2. Centre d'études européennes et de politique comparée (CNRS/Sciences-Po Paris).
- 3. Centre de recherches internationales (CNRS/Sciences-Po Paris).
- 4. Géographie-cités (CNRS/Univ. Paris-1 Panthéon Sorbonne/Univ. Paris Diderot).
Voir aussi
Auteur
Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.