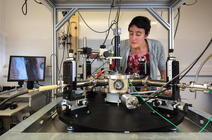Vous êtes ici
Eva Illouz, une sociologue contre la tyrannie des émotions

Cet article a été publié dans le n° 8 de la revue Carnets de science en vente en librairies.
L’originalité d’une œuvre réside, selon le dictionnaire, dans sa nouveauté, son caractère unique : elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Depuis trente ans, l’œuvre d’Eva Illouz est absolument originale. « Elle a contribué au renouveau de la pensée critique, explique le sociologue Luc Boltanski. L’un de ses apports a été de faire converger les recherches de deux champs disciplinaires jusque-là opposés : celui de l’économie et celui des émotions. » La pensée de la sociologue franco-israélienne, chercheuse au Centre européen de sociologie et de science politique1, est aujourd’hui reconnue par ses pairs, par les médias et par le grand public. Lauréate en 2018 en Israël du prestigieux prix Emet, elle est fréquemment citée par les journaux (Die Zeit en 2009, Le Point en 2013 ou encore L’Obs en 2020) parmi les intellectuels qui comptent. Et ses ouvrages sont à l’image de ceux de Roland Barthes, qu’elle admire : écrits dans une langue simple mais précise, ils offrent à un large public un éclairage inspirant sur notre société. Pour comprendre comment naît une œuvre originale, le mieux est de le demander à son autrice.

Après avoir enseigné en Israël, en Allemagne et aux états-Unis, Eva Illouz a posé ses valises à Paris il y a cinq ans, où elle est directrice d’études à l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS). L’immeuble, situé dans le très haussmannien quartier Sèvres-Babylone, est d’architecture moderne et le bureau tout en longueur qu’elle partage avec un autre chercheur est sobrement décoré. « Comment je suis devenue sociologue ? » Eva Illouz a plus l’habitude de parler du fruit de ses recherches que d’elle-même. élégante et souriante, elle cherche souvent ses mots, dans un éternel souci de précision. « Une vocation professionnelle, c’est un peu comme une histoire d’amour, c’est à la fois le fruit du destin et du hasard. »
Du Maroc à Paris, puis ailleurs
Eva Illouz naît en 1961 à Fès dans une famille juive sépharade. Son père, émile-Haïm, est bijoutier ; sa mère, Alice, s’occupe des cinq enfants. « Une partie de mes ancêtres est arrivée au Maroc après avoir fui l’Inquisition espagnole de 1492. Les pays du Maghreb ont longtemps exercé un pouvoir politique bienveillant envers les minorités juives. » Mais après la guerre des Six jours, qui oppose en 1967 Israël à l’égypte, la Syrie, la Jordanie et le Liban, des tensions grandissent au Maroc entre musulmans et juifs, et la famille Illouz envisage de partir.
« Les juifs vivent partout avec l’idée qu’un jour ils devront peut-être partir. Je me rappelle distinctement qu’enfant, je me posais la question : quelle est la vraie patrie ? Israël ou la France ? D’un côté, même si nous n’avions pas la nationalité française, nous parlions français à la maison, fruit du passé colonial du Maroc. De l’autre, mes parents étaient religieux et sionistes2. Au final, ce fut la France, mes parents considérant que nous y recevrions une meilleure éducation. Et la France est restée ma patrie d’élection. »
En 1971, la famille Illouz s’installe à Sarcelles, en région parisienne, où réside l’une des plus importantes communautés juives de France, et obtient la naturalisation française. C’est pour Eva, alors âgée de 10 ans, le premier grand déménagement d’une longue série : depuis, sa vie a été rythmée par les changements de villes, de pays et de continents. Sept ans plus tard, alors que la famille s’est installée à Paris, elle passe un bac littéraire puis entreprend des études de lettres à l’université de Nanterre. Son mémoire de maîtrise, à la frontière entre la littérature et la sociologie, porte sur un sujet qui lui est proche : l’identité juive chez Albert Memmi, le père du concept de judéité, et chez l’écrivain Albert Cohen. En 1983, le besoin d’avoir un contact direct avec Israël et le sionisme se fait sentir. Répondant à l’appel de l’Agence Juive, Eva Illouz fait son alya, s’installe à Jérusalem, apprend l’hébreu et acquiert la nationalité israélienne.

« J’y ai découvert la pensée anglo-saxonne, qui est très différente de la pensée française. Je m’intéressais aux médias, à la technologie, aux journaux féminins, aux romans à l’eau de rose, à la publicité, au cinéma... Ces domaines d’étude, à l’époque déconsidérés en France – en dehors de Roland Barthes –, ne l’étaient ni aux états-Unis ni en Israël. J’ai donc fait un second master, en communication cette fois (media studies). Mon sujet était une étude comparative de la représentation de l’amour dans la culture d’élite et la culture populaire. J’essayais par exemple de comprendre pourquoi au XXe siècle l’amour malheureux était valorisé dans les films et romans destinés aux élites culturelles alors que dans les œuvres populaires, comme les films hollywoodiens, le happy end prévalait. »
Sentiments et capitalisme
L’intuition forte qui va marquer toute son œuvre à venir, Eva Illouz la ressent à la fin des années 1980. Elle s’est installée aux états-Unis, à la prestigieuse University of Pennsylvania où elle prépare un doctorat à l’Annenberg School of Communications. Son sujet porte toujours sur l’amour, mais avec un champ d’étude élargi aux expériences.
« J’interrogeais des gens sur leurs pratiques amoureuses. Quand je leur demandais ce qu’était pour eux un moment heureux en amour, ils me répondaient typiquement “un repas au restaurant” ou “un voyage au Mexique”. J’ai mis du temps à comprendre la structure conceptuelle derrière ces réponses : tous me parlaient d’une activité de loisir. »
Après ce moment de conceptualisation sociologique, la doctorante entreprend une démarche historique pour déterminer quand les sentiments ont commencé à être liés aux pratiques de consommation, jetant les fondements d’une grande partie de son travail à venir : la jonction entre sentiments et capitalisme.
Jusque-là, l’amour était étudié avec les outils de la psychologie, de la psychanalyse, voire de la sémiotique. On cherchait ses causes dans le passé d’un individu ou dans son entourage. L’idée de la chercheuse est que les émotions dépendent d’images, de discours, de répertoires moraux, de normes qui au début du XXe siècle changent profondément sous l’impact du capitalisme. L’amour se trouvait déjà en filigrane dans l’œuvre de sociologues comme Durkheim, Weber, Marx ou Engels. Il assume un rôle plus central chez trois sociologues contemporains importants – Niklas Luhmann, Anthony Giddens et Ulrich Beck – mais aucun ne le traite vraiment comme une émotion.
Sociologie de l'amour
Dans Pourquoi l’amour fait mal, l’ouvrage qui a fait connaître Eva Illouz en France en 2012, elle décortique les causes sociales de la souffrance amoureuse actuelle, en la comparant à celle des sociétés traditionnelles. Elle y montre, notamment, que les souffrances amoureuses contemporaines sont liées au problème moderne de la construction de l’estime de soi : l’individu n’étant plus intégré à des groupes, il doit créer et négocier son « statut » et sa « valeur » au fil d’interactions avec les autres. Le moi se met alors en quête d’une reconnaissance sociale, à l’œuvre dans le lien amoureux. « Contrairement à la période précapitaliste où les relations entre les hommes et les femmes étaient très codifiées et les émotions régulées, analyse-t-elle, la libération sexuelle des années 1970 a permis la mise en place d’un “marché de l’amour” où tous et toutes se rencontrent, sans intermédiaires, et où la valeur de chacun est attribuée selon des mécanismes qui ressemblent à ceux du marché. Cela crée à la fois de l’incertitude et de nouvelles formes d’inégalités. »

Eva Illouz est donc venue à la sociologie au détour d’un parcours éclectique : si elle a suivi des cours au département de sociologie d’Erving Goffman et si sa thèse avait une orientation sociologique, son diplôme ne l’était pas. « En 1991, après ma thèse en communication, l’université de Tel Aviv m’a proposé un poste de professeur de... sociologie. Je n’avais pas étudié les cours d’introduction à la sociologie. Je les ai donc appris en même temps que je les enseignais à mes élèves ! » s’amuse-t-elle. Depuis, elle a été appelée à donner des cours et des conférences un peu partout dans le monde : dans les universités de Princeton, Harvard, Columbia, Yale, Québec, Zurich, Jérusalem, Cambridge, Oxford, Taipei ou encore Berlin. Avant de poser ses valises en 2015 à l’EHESS.
Une démarche scientifique
En parallèle à l’enseignement, Eva Illouz continue de creuser le sillon de ses recherches : « Comme dans les sciences dures, tout commence souvent par un moment de la pensée qui ne s’explique pas, une intuition, fruit de la confrontation entre un savoir accumulé et quelque chose qui fait problème. » Pour son dernier livre, La Fin de l’amour, le point de départ est le constat que la sexualité est un lieu où se confrontent à la fois un idéal d’authenticité et de nouvelles formes d’exploitations économiques. « Pour moi, réfléchir est toujours comparatif. Orwell disait qu’il fallait constamment se battre pour voir ce qui est sous son nez. L’une des façons de prendre de la distance est de comparer présent et passé. Par exemple, dans le cas de La Fin de l’amour, pour comprendre l’incertitude qui domine la sexualité contemporaine, j’ai étudié les formes sociales qui l’ont précédée. Autrefois, quand on faisait sa cour, on savait plus ou moins quelles règles sociales étaient à l’œuvre. Je me suis alors demandé quels mécanismes sociologiques stabilisaient l’expérience des sentiments. Ce qui est très difficile dans les sciences sociales, c’est la construction de l’objet : je passe la moitié de mon temps de réflexion à essayer de cerner et de construire l’objet que je veux analyser. »
À ce stade de son travail, Eva Illouz entame un va-et-vient entre la théorie – la structure conceptuelle de son argumentation – et l’empirique – l’observation des données, qui l’aident à construire et à faire évoluer le cadre théorique. L’une des forces de ses ouvrages est le foisonnement des références et des exemples : ouvrages de sociologie, bien sûr, mais aussi articles puisés dans des magazines féminins, romans allant de Guerre et Paix de Tolstoï à Cinquante nuances de Grey de El James, blogs d’influenceuses américaines, statistiques sur les divorces aux États-Unis, films cultes ou nanars, messages postés sur Facebook, chat rooms, sites internet de rencontre... Un vrai panorama de notre culture, mêlant indifféremment matériaux dits « populaires » et savoir universitaire.
« J’essaie toujours de me laisser surprendre par ce que je trouve. La critique littéraire Barbara Johnson disait qu’en lisant un texte, elle attendait le moment où il lui dirait : “ Pousse-toi de là ! ” C’est cela, réfléchir : chercher à être déstabilisé par ce que l’on examine ! Comme Max Weber le préconisait pour tout travail scientifique, je suis agnostique : je n’ai pas de dieu sociologique donné. J’observe et j’interroge tous les dieux du Panthéon ! »
La tyrannie du bonheur
L’amour n’est pas le seul sentiment étudié par la sociologue. En 2003, elle publie aux états-Unis un livre non traduit en français sur la manière dont l’animatrice de talk-shows américaine Oprah Winfrey met en scène la souffrance de ses invités et leur dépassement de soi pour s’en sortir, et ce que cela révèle de la culture américaine, où dominent des notions comme la valeur personnelle. En 2017, dans Happycratie, coécrit avec le psychologue espagnol Edgar Cabanas, elle explique comment une nouvelle science psychologique, dite du « bonheur », s’est mise au service d’entreprises ou de nouvelles politiques d’états. « L’histoire du développement personnel est ancré dans l’histoire du self-help, qui date de la moitié du XIXe siècle, mais vers la fin des années 1990, l’Américain Martin Seligman fonde la psychologie positive et la dote d’une assise soi-disant scientifique. »

Depuis, les guides de développement personnels, les blogs, les thérapies ou le coaching prolifèrent et expliquent que chacun peut – et doit – accéder au bonheur en travaillant sur lui-même et en posant un regard positif sur le monde. Le bonheur est devenu une quantité « mesurable », utilisée par exemple pour évaluer l’état d’un pays.
En 2016, les émirats arabes unis ont créé un ministère du Bonheur et il existe dans certaines entreprises le poste de chief happiness officer, dont la mission est de vérifier que l’environnement de travail contribue au bien-être des employés. « La théorie du self-help est du pain béni pour les multinationales et les gouvernements néolibéraux, qui l’utilisent pour faire du moi un capital à exploiter et à mettre au service d’un marché », met en garde Eva Illouz.
En 2019, la chercheuse poursuit l’exploration sociologique de nos émotions dans l’essai collectif Les Marchandises émotionnelles. Dans Le Capital, Marx définissait une marchandise comme un objet solide. Plus tard, chez Baudrillard, elle devient dématérialisée : c’est un ensemble de signes. En s’appuyant sur des exemples aussi divers que le Club Med, la musique d’ambiance ou l’univers des cartes de vœux, Eva Illouz propose une troisième catégorie : l’emodity, ou marchandise qui produit de vraies émotions au moment même de sa consommation, au point de faire de ces émotions la valeur même de cette marchandise. « Le Club Med a ainsi changé la conception du tourisme. Avant, il y avait le tourisme de luxe, médical ou éducatif. Le Club, lui, vend essentiellement une émotion, la relaxation, pour répondre à une pathologie émotionnelle créée au XIXe siècle, le stress. Le capitalisme utilise les émotions comme aucune formation économique avant lui. »
Entre doute et certitude
La pertinence et la modernité des sujets abordés par Eva Illouz, ainsi que sa capacité à en parler de manière claire, en font une invitée de choix pour les journalistes. Un marathon médiatique accompagne la sortie de chaque nouveau livre. « J’ai l’impression d’avoir une double personnalité intellectuelle. Quand je prends la parole dans la sphère publique, je sais exactement ce que je pense. Je suis même devenue celle qu’on interroge pour avoir un avis sur des points d’actualité comme le phénomène #MeToo ou la politique israélienne. En revanche, quand je fais mes recherches, je ne sais plus véritablement ce que je pense : il me faut assembler un puzzle sans image directrice, essayer de voir apparaître des lignes de force, des logiques ou des contradictions... Je me sens plus libre dans cette seconde identité : je ne suis pas astreinte à une opinion que je connais d’avance. »
Voilà peut-être ce qui permet à Eva Illouz de poser un regard original sur notre société : elle est à la fois partout chez elle et étrangère partout. « Ma langue maternelle est le français, mais je pense en anglais », explique-t-elle. Tous ses livres publiés en France sont d’ailleurs des traductions. « Et je gronde ou dis des mots tendres à mes enfants en hébreu ! !&nb» Bien sûr, sa pensée et ses ouvrages suscitent des critiques. Sur la Toile, les commentaires sont parfois acerbes : dans l’esprit de certains internautes, puisque la sociologue pose un regard critique sur le néolibéralisme, c’est qu’elle est forcément marxiste. « J’ai bien sûr ma sensibilité politique et morale, mais je ne la mets jamais en avant. Je m’oblige toujours à multiplier les points de vue et il m’arrive souvent d’écrire contre moi-même, contre mes propres opinions. Ce sont d’ailleurs les moments d’écriture que je préfère ! En fait, j’ai l’impression de travailler avec un kaléidoscope devant les yeux : je tourne constamment la lunette et vois se former de nouvelles images. » ♦
Eva Illouz en 8 dates
1961 Naissance à Fès, au Maroc.
1991 Doctorat à l’université de Pennsylvanie, aux états-Unis.
2000 Professeure de sociologie à l’université hébraïque de Jérusalem, en Israël.
2008-2009 Membre du WissenschaftsKolleg (Institut d’études avancées), Berlin, en Allemagne.
2012 Première femme présidente de l’Académie des beaux-arts de Bezalel, à Jérusalem.
2015 Directrice de recherche à l’école des hautes études en sciences sociales, à Paris.
2018 Membre du Princeton Institute for Advanced Studies, aux états-Unis.
2018 Prix Emet pour l’ensemble de son œuvre.
Ses principaux ouvrages
La Fin de l’amour. Enquête sur un désarroi contemporain, Eva Illouz, Seuil, 2020.
Les Marchandises émotionnelles. L’authenticité au temps du capitalisme, Eva Illouz (dir.), Premier Parallèle, 2019.
Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, Edgar Cabanas, Eva Illouz, Premier Parallèle, 2018.
Hard Romance. Cinquante nuances de Grey et nous, Eva Illouz, Seuil, 2014.
Pourquoi l’amour fait mal. L’expérience amoureuse dans la modernité, Eva Illouz, Seuil, 2012.
Les Sentiments du capitalisme, Eva Illouz, Seuil, 2006.
- 1. Unité CNRS/Université Panthéon-Sorbonne/ EHESS.
- 2. Selon le CNRTL, le sionisme est un mouvement politique et religieux, provoqué au XIXe siècle par l’antisémitisme russe et polonais, activé par l’affaire Dreyfus, et qui, visant à l’instauration d’un Foyer national juif sur la terre ancestrale, aboutit en 1948 à la création de l’État d’Israël.
Voir aussi
Auteur
Ingénieur de formation et titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’art, Philippe Nessmann a trois passions : les sciences, l’histoire et l’écriture. En tant que journaliste, il a écrit pour Science et Vie Junior, Ciel et Espace, le journal du CEA… Il est également l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages pour la jeunesse, parmi lesquels des romans historiques (coll. « Découvreurs du...