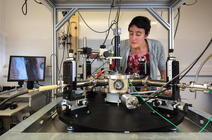Vous êtes ici
Barbara Cassin, le pouvoir des mots
Temps de lecture : 13 minutes
On peut la présenter comme helléniste, philologue et philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS… avec le sentiment de rester loin de la vérité pour décrire cette intellectuelle énergique. Ces derniers mois, Barbara Cassin a endossé le costume de commissaire d’exposition et imaginé pour le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), à Marseille, l’exposition « Après Babel, traduire », tout en s’attaquant à un monumental dictionnaire sur les trois monothéismes. Ses recherches l’ont menée de Homère à Heidegger en passant par Leibniz et la psychanalyse, sans parler des nombreux programmes d’échanges culturels auxquels elle a contribué. Au moment de la rencontrer chez elle, dans son jardin d’hiver au cœur du Quartier latin, on se demande quel fil tirer pour résumer sa bibliographie, foisonnante, ses travaux et ses engagements multiples. « C’est simple, répond-elle. Je me suis toujours occupée de ce que peuvent les mots. »
Le pouvoir des mots, la petite Barbara, née à Boulogne-Billancourt deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, n’a pas attendu d’atteindre l’âge de raison pour le percevoir. Ou plus exactement la petite Laure ou la petite Sylvie, puisque ses parents lui ont donné trois prénoms, sans se douter qu’elle apprendrait très tôt à en jouer, préférant l’un ou l’autre selon ses humeurs ou ses envies. Jusqu’à ce qu’elle se fixe, à l’adolescence, sur Barbara, si proche de ce « barbare » que les Grecs utilisaient dans l’Antiquité pour désigner ceux qui ne parlaient pas leur langue. Car elle a fait son choix : elle veut se confronter à d’autres langues, un passage obligé pour multiplier les points de vue sur le monde.
Sa rencontre, au lycée, avec un professeur de grec lui a fait aimer cette langue et ses grands textes philosophiques. D’autres voies l’attiraient pourtant : le théâtre, la peinture, la poésie, la famille… Pourquoi avoir choisi la philosophie ? « Parce que c’est le chemin qui me semblait le plus difficile », explique cette boulimique de travail.
Dès ses premiers travaux d’étudiante, la « méthode Cassin » se met en place. C’est par le biais du langage et du discours qu’il faut aborder la philosophie et ses questions fondamentales : que peut-on savoir de l’être et de la nature ? Pour obtenir sa maîtrise de philosophie à la Sorbonne, en 1968, elle s’intéresse aux grands débats métaphysiques qui ont agité la fin du XVIIe siècle, bouleversée à la fois par la révolution scientifique et le coup de jeune apporté par Descartes à la pensée. Mais elle choisit d’y entrer par le biais d’un échange de lettres entre le philosophe et mathématicien Leibniz et un adversaire des thèses cartésiennes, le théologien belge Antoine Arnauld : son intérêt se porte moins sur la pertinence des thèses défendues par l’un et l’autre que sur les figures logiques et rhétoriques qu’ils utilisent pour argumenter et emporter la conviction. Pour la philosophe, ces discours-là sont plus importants que la recherche de la vérité, car ce sont eux qui font les sociétés. Les décrypter consiste, en quelque sorte, à « déniaiser » notre croyance en la philosophie. Dès lors, elle ne lâchera plus cette volonté de se plonger dans l’étude du langage. Elle emprunte à Novalis un terme pour désigner cette activité : la « logologie ».
Le programme est ambitieux et son amour des mots ne manque pas de jouer des tours à la jeune philosophe. À l’étroit dans les cases des disciplines universitaires, elle mêle joyeusement la littérature, l’histoire et la dialectique… Cette incapacité à cloisonner les différents types de discours ne lui facilite pas la tâche : elle se lance à l’assaut de l’agrégation sur laquelle elle se cassera les dents… six fois ! « À la troisième tentative, j’ai traduit d’une façon un peu personnelle le rapport entre le Dieu d’Aristote et celui de Leibniz : on passe d’un Dieu premier moteur à un Dieu promoteur, et j’en étais très fière », s’amuse-t-elle. L’examinateur ne partageait manifestement pas son sens de la formule : elle s’en est sortie avec une note de 2/20.
Rencontre avec Heidegger
À défaut d’entamer une brillante carrière universitaire, Barbara Cassin a pu, durant toutes ses années d’étudiante, « travailler comme jamais » et accumuler les connaissances et les rencontres décisives. Par l’intermédiaire de ses professeurs Jean Beaufret et Michel Deguy, elle a notamment l’occasion de participer à l’un des séminaires de Martin Heidegger, le philosophe allemand dont la pensée sur l’Être et sur le langage aura une influence considérable durant la seconde moitié du XXe siècle dans tous les milieux intellectuels. À l’époque, à la fin des années 1960, Heidegger n’est pas encore l’objet des polémiques qui éclateront sur son passé nazi. Même si Barbara Cassin, qui est juive, ne l’ignore pas, cela ne présente pas un obstacle à ses yeux. Elle partage l’argument de Hannah Arendt, dont elle est l’une des premières traductrices, pour qui les philosophes ont toujours éprouvé une certaine tendresse pour les tyrans : le même homme peut être à la fois un grand penseur et un nazi ordinaire, la philosophie doit faire avec.
Rester « loin des escaliers de la Sorbonne » permet aussi à l’étudiante de s’orienter vers le Capes et de multiples formes d’enseignement, « des expériences très importantes, parce qu’elles vous obligent à inventer tout le temps », analyse-t-elle. Elle demande par exemple à des étudiants matheux et narquois de réfléchir à la notion de nombre. A des élèves de l’ENA tenus de réfléchir et travailler en groupe mais notés individuellement, elle explique pourquoi cette aberration les forme au métier de diplomate.
Quel que soit le cadre dans lequel elle enseigne, c’est toujours à la puissance des mots que Barbara Cassin conduit ses étudiants. L’expérience qui l’a marquée le plus durablement est sans aucun doute ces deux années passées avec les adolescents psychotiques de l’hôpital Étienne-Marcel, à Paris, où exerçait Françoise Dolto. Pour surmonter les troubles de langage considérables dont souffrent ces jeunes, la professeure les met à l’écriture et à la réalisation d’un véritable journal qu’ils s’en vont vendre dans la rue. Autre exercice, en écrivant au tableau des mots grecs qu’ils ne comprennent pas, elle leur fait prendre conscience qu’il y aussi des mots qu’ils comprennent parce qu’ils ont une langue maternelle… Dès lors, Barbara Cassin fait entrer la psychanalyse dans le champ, déjà très vaste, de ses investigations. Ce sera l’occasion pour elle de publier plusieurs ouvrages sur Lacan, dont l’un coécrit avec Alain Badiou1, connu surtout pour ses engagements politiques, mais qui a aussi réalisé de nombreux travaux en philosophie logique.
Elle ne lâche pas pour autant la philosophie. Bien au contraire. En 1984, elle est recrutée par le CNRS au Centre Léon-Robin2, centre de recherches sur la pensée antique. Et dix ans plus tard, elle est enfin reconnue par l’institution universitaire : elle soutient brillamment une thèse de doctorat d’État, publiée sous le titre L’Effet sophistique3. Elle y remet à l’honneur une école philosophique évincée depuis deux millénaires. Prospères dans le monde grec d’avant Socrate, ceux que l’on nommera plus tard les sophistes faisaient profession d’enseigner l’art de persuader un juge, un opposant, une assemblée. Très vite, Platon, dans son dialogue Gorgias, puis Aristote dénoncent les raisonnements parfois fallacieux que ces professionnels du langage mettent au service de leur éloquence. Ce point de vue a prévalu jusqu’à nos jours : le sophisme est défini comme un raisonnement purement verbal, sans solidité et reposant sur une logique fallacieuse. Tout le monde connaît le syllogisme qui fait d’un cheval bon marché un produit cher, parce que tout ce qui est rare est cher.
Pour sa thèse, Barbara Cassin est remontée à la source, c’est-à-dire aux textes des sophistes eux-mêmes, en particulier ceux de Gorgias. Elle a retraduit son Éloge d’Hélène, où il plaide pour innocenter Hélène, qui a pourtant provoqué la guerre de Troie. C’est par son discours, soutient Barbara Cassin, et par sa puissance logique que Gorgias parvient à renverser la situation, réalisant une performance au sens littéral du terme. C’est cette performance logique qu’elle traque alors dans les dialogues socratiques. Bien que Platon se moque des sophistes, elle souligne comment ceux-ci nous font comprendre que les vérités philosophiques, même considérées comme les plus fondamentales, sont d’abord un effet du discours. Or, en expulsant d’entrée de jeu la sophistique comme un repoussoir et comme une voie à fuir à tout prix, la philosophie s’est privée de ce que la chercheuse appelle « la mesure du vrai ». « La philosophie est une tradition toute-puissante, mais on ne parvient à comprendre comment elle opère qu’à condition d’être un peu en dehors, dans une forme de déterritorialisation. Voilà l’effet de la sophistique. »
Pour Barbara Cassin, cela ne fait aucun doute : les mots ont le pouvoir de faire advenir les choses. En cela, ils ont aussi une dimension politique. Elle a pu le démontrer lors de l’avènement de Nelson Mandela à la présidence de l’Afrique du Sud, en contribuant, via un accord international avec le CNRS, à la Commission Vérité et Réconciliation mise en place en 1995 dans le cadre de la fin de l’apartheid et de la transition démocratique. « Avec Barbara, nous avons réfléchi en philosophes sur la réconciliation et, dans notre rapport, nous avons exposé comment on pouvait obtenir la pacification de la nation grâce aux ressorts de la rhétorique, raconte Philippe-Joseph Salazar, doyen de la Faculté des lettres du Cap. Ce qu’on présentait en Europe comme des débats judiciaires étaient en réalité des débats politiques et ils allaient contribuer à élaborer la forme éthique du nouvel État. » Ou comment les mots peuvent contribuer à construire une nation. Rwanda, Tunisie, Côte d’Ivoire, Pérou…, ce rapport, que le rhétoricien n’hésite pas à placer à l’égal du Contrat social de Rousseau, est devenu une référence obligée dans tous les pays qui, depuis, ont créé ce type de commission. Même si, regrette Philippe-Joseph Salazar, son adaptation à chaque pays et dans différentes langues ne se fait pas sans mal.
L’aventure des intraduisibles
Une problématique que Barbara Cassin connaît bien. La réflexion sur le sens des mots quand ils voyagent d’une langue à l’autre la préoccupe depuis longtemps. Voilà vingt ans qu’elle s’interroge sur ce que pourrait être une philosophie européenne à l’heure du « globish », cet anglais globalisé pratiqué dans le monde entier. Une première réponse est venue en 2004, sous la forme d’un objet unique dans l’histoire de la philosophie, pour ne pas dire de l’édition : le Vocabulaire européen des philosophies, plus connu par son sous-titre, le Dictionnaire des intraduisibles. Ce monument examine plus de 1 500 mots du langage philosophique confrontés à la difficulté de leur traduction dans une quinzaine d’autres langues. « Quand on traduit, le sens n’est plus tout à fait le même ni tout à fait autre, lance la philosophe, il y a toujours plus d’une bonne traduction possible. D’ailleurs, même le mot traduire est polysémique ! » Le dictionnaire, pour lequel elle a réussi à mobiliser cent cinquante chercheurs et traducteurs à travers le monde, ne donne donc pas la bonne traduction, il montre au contraire les discordances et les différences : les « intraduisibles » sont « non pas ce qu’on ne traduit pas, mais ce qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire ».
Barbara Cassin le revendique comme un geste politique. De même, elle a imaginé l’exposition du MuCEM « Après Babel, traduire » comme la démonstration au sens littéral d’un savoir-faire de la diversité : ici, pas de sémiologie, on apporte la preuve par les œuvres. Cette reconnaissance de la diversité, c’est aussi une affirmation féministe pour Barbara Cassin, qui considère que les notions d’« universel » et de « vérité avec un grand V » sont le fruit d’un rapport masculin à la philosophie. C’est d’ailleurs un autre débat qui anime ses discussions avec Alain Badiou, avec qui elle prépare un ouvrage sur la manière dont homme et femme se rapportent à la philosophie.
Avant cela, il y aura sans doute la parution d’un nouveau Dictionnaire des intraduisibles, celui des trois monothéismes cette fois, parce que les trois grands textes sacrés, la Torah, la Bible et le Coran, ont eux aussi beaucoup à nous dire sur le rapport que nous entretenons avec les langues et les mots. « Il faudra d’abord trouver les financements, parce que ce type d’ouvrage est très coûteux », soupire Barbara Cassin. « Il faut avoir le cœur bien accroché pour que de tels projets d’érudition entrent dans les systèmes de financement », ajoute en écho Philippe-Joseph Salazar, qui souligne la marginalité des experts du langage en Europe quand, aux États-Unis, les congrès de rhétorique réunissent des milliers de participants.

Barbara Cassin, elle, ne redoute rien tant que se laisser happer par le temps. Une chaire à la Sorbonne ? Elle a refusé, de peur de ne plus pouvoir continuer ses travaux dans le monde entier. Des engagements militants ? Trop prenant. Idem pour les calculs politiques ou le réseautage qui vous font grimper les échelons de la hiérarchie. « Tout ce qui s’est passé pour moi au CNRS, jusqu’à devenir directrice du Centre Léon-Robin, est arrivé uniquement parce que j’ai eu beaucoup de chance. Je ne l’ai jamais vraiment voulu et encore moins demandé », assure-t-elle. Son temps, elle veut le préserver pour creuser « son » sillon : quand dire, c’est vraiment faire. Au risque, avoue-t-elle, de se répéter, surtout quand on travaille, comme c’est son cas, sur plusieurs ouvrages en même temps, sans compter les articles, les contributions, les expositions… « Alors j’écris comme je peins, lâche-t-elle, en attendant d’être surprise. » Elle nous désigne deux de ses tableaux accrochés l’un au-dessus de l’autre, même format, mêmes tons et presque les mêmes personnages. Les deux toiles (ci-dessus) ont cependant plus de vingt ans d’écart : la première représente ses deux fils, 8 et 3 ans, la seconde, ses deux petits-fils aux mêmes âges. Presque une répétition, mais avec d’infimes différences. « Écrire sur le langage doit avoir le même effet que peindre, commente-t-elle. Se surprendre soi-même et changer son regard sur les choses. Littéralement, se rincer l’œil. »
Cet article a été initialement publié dans le numéro 2 de la revue Carnets de science.
- 1. Barbara Cassin et Alain Badiou, Il n’y a pas de rapport sexuel. Deux leçons sur « L’Étourdit » de Lacan, éd. Fayard, coll. « Ouvertures », 2010.
- 2. Unité CNRS/Université Paris-Sorbonne/École normale supérieure de Paris.
- 3. Barbara Cassin, L’Effet sophistique, Gallimard, coll. « NRF Essais », 1995.