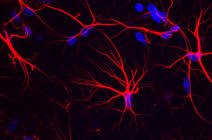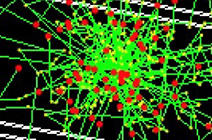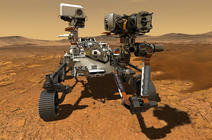Vous êtes ici
La ménopause est-elle une construction sociale ?
Temps de lecture : 14 minutes
On découvre dans votre livre, La Fabrique de la ménopause (CNRS Éditions, 2019), que le terme de ménopause a une date de naissance assez récente, 1821, et un lieu de naissance, la France. Quel est le contexte de sa création ?
Cécile Charlap1 : C'est un médecin français, Charles de Gardanne, qui invente ce terme dans une période d'intérêt grandissant pour les maladies des femmes. À partir du XVIIIe siècle, dans le contexte de renouveau des Lumières, avec l'essor de la science naturelle, des catégorisations, de la rationalité, on voit s'affermir une pensée bicatégorielle du corps, avec un corps féminin et un corps masculin perçus comme des entités différentes et opposées.
Jusqu'alors, le corps féminin était pensé comme une version moindre du corps masculin mais sur un même continuum. On employait par exemple le terme « climatère », hérité de l'Antiquité, pour désigner ce moment de crise du vieillissement humain, donc pas du tout propre aux femmes ni centré sur la cessation des règles et de la fécondité. Cette construction d'une biologie féminine va se poursuivre tout au long du XIXe siècle. Avec l'essor de la psychiatrie, la ménopause sera même pensée, dans le contexte des Folles de Charcot, comme la cause de maladies mentales et de fureurs cleptomanes ou sexuelles.



C'est aussi un concept occidental. Vous expliquez que dans le Japon traditionnel par exemple, il n'y a pas de mot pour désigner la ménopause…
C. C. : L'anthropologue Margaret Lock a montré que dans le Japon d'avant les années 1990, il n'existe pas de terme équivalent à cette notion d'arrêt de la fertilité et des règles. Il y a un terme, le « konenki », qui englobe le vieillissement en général, féminin comme masculin : le blanchissement des cheveux, le raidissement du corps, etc. Cela renvoie à des représentations du corps différentes : en Occident le corps est perçu comme éminemment individuel, alors que pour les Japonais, il renferme une sorte d'énergie vitale, le « ki », reliée aux autres, à la communauté et plus largement au Cosmos. Il s'agit aussi de visions différentes de la fécondité et de la maternité. Si, en Occident, être féconde c'est mettre au monde un enfant, au Japon cette notion se poursuit dans l'éducation : les grands-mères rencontrées par Margaret Lock se sentaient toujours fertiles parce qu'elles s'occupaient des petits-enfants.

Ce concept de ménopause s'est construit sur un mode pathologique, dans des ouvrages médicaux développant une rhétorique du déclin. Vous dites que le symptôme, la déficience et le risque y apparaissent comme les trois Parques…
C. C. : La ménopause est dite par les médecins, pensée dans le cadre médical et associée à trois registres. D'abord le symptôme, qui va former une sorte de grammaire du corps que les femmes apprennent au cours de leur vie. Au XIXe siècle, on associait à la ménopause des cortèges de symptômes assez impressionnants, des bouffées de chaleur au penchant à l'alcoolisme… La symptomatologie a aujourd'hui évolué mais elle reste importante aussi bien sur le plan physique que psychique.
Le deuxième registre est la déficience, cette idée que la ménopause n'est pas une transformation hormonale mais une perte, établie à partir d'un standard correspondant aux taux hormonaux des femmes en période de fécondité, comme si le corps fécond était la norme. Enfin, le troisième registre est celui du risque : de cancer, d'ostéoporose et en général d'altération de la qualité de vie, comme si cette altération n'était pas le propre du vieillissement mais celui de la ménopause.
La ménopause a également évolué au gré des avancées de la discipline médicale…
C. C. : Au début du XIXe siècle, lorsque la notion émerge, on pense le corps en termes d'« humeurs ». On explique la ménopause par un manque de force chez les femmes, avec l'âge, pour expulser le sang menstruel, et cette rétention sanguine serait la cause de nombreux troubles : cancers, inflammations, polypes, ulcères… Les médecins proposent alors aux femmes l'imposition de sangsues ou des saignées. Ces prescriptions sont très ancrées dans leur époque. Au milieu du XIXe siècle, les médecins déconseillent aux femmes ménopausées de faire du vélo ou de prendre le train, reproduisant les préjugés d'alors sur les dangers de la vitesse.

Ensuite, au tournant du XXe siècle, une conception hormonale du corps va peu à peu s'imposer et la ménopause sera pensée comme une maladie de la carence en œstrogènes, en lien étroit d'ailleurs avec le développement des hormones de synthèse par les industries pharmaceutiques, qui culmineront dans les années 1960 à 1980. Ces traitements hormonaux de substitution (THS) sont aujourd'hui en perte de vitesse sur le marché occidental, depuis que deux études2 ont établi des liens entre prise de THS et cancer, mais le marché asiatique a explosé depuis les années 1990.
Cette approche pathologique construit une image très négative du vieillissement féminin. Qu'est-ce que cela dit des représentations de la femme et des rapports sociaux de sexe ?
C. C. : Ma thèse, c'est que la construction de la ménopause est éminemment ancrée dans les rapports sociaux de sexe et la hiérarchie du masculin et du féminin, dans laquelle le corps masculin est pensé avant tout comme stable et du côté de la raison, quand le corps féminin serait le lieu de la « nature », des tourments, de l'instabilité.
Notre conception de la ménopause, qui vient renforcer cette représentation, introduit l'idée d'un vieillissement plus précoce et plus déficitaire pour les femmes que pour les hommes. On l'observe dans l'espace public, avec un Sénat rempli d'hommes aux cheveux blancs valorisés pour leur expérience et leur maturité. Le corps des femmes est par ailleurs pensé du point de vue de la fécondité et d'attributs esthétiques très valorisés. Ainsi, la mise en exergue de la stérilité et de l'altération des qualités esthétiques organise des représentations du vieillissement au féminin qui font que, pour les femmes, vieillir c'est perdre de la valeur sociale. On le voit bien sur le marché amoureux, où elles perdent beaucoup plus rapidement de la valeur que les hommes.
Cette image hérite aussi de représentations particulières du sang menstruel…
C. C. : Les représentations de la ménopause sont associées à celles des menstruations. En Occident, le sang menstruel est pensé comme un sang particulier. Dans l'histoire de l'art par exemple, on voit sur des milliers de tableaux le sang couler d'une blessure, mais représenter le sang menstruel est proprement interdit par nos normes. C'est un sang qu'une femme doit absolument avoir sous peine de n'être pas pensée comme une femme, et qu'elle doit en même temps absolument rendre invisible. Et puis, à partir de l'adolescence, vont s'élaborer pour elles des injonctions à la surveillance médicale de ce sang et du corps.
Ce cadre médical façonne l'expérience intime des femmes dans ce que vous nommez un « parcours d'apprentissage ». Quel est-il ?
C. C. : L'expérience de la ménopause n'est pas seulement physiologique, c'est une expérience sociale car elle s'apprend, notamment en interaction avec le médecin. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ont parlé de la ménopause avec un médecin, qui joue un rôle d'éducateur : il délivre une grille de symptômes de la ménopause qui va fonctionner comme grille de lecture du corps.
Mais la ménopause n'est qu'un des épisodes d'une socialisation qui commence dès la puberté. L'apprentissage de la surveillance du corps, qu'il s'agisse des menstruations ou de la gestion de la contraception du couple, pèse surtout sur les femmes. Il ne viendrait pas à l'esprit, pour des parents, de demander à leur fils s'il a bien du sperme ni de l'emmener voir un médecin pour en discuter, alors que le corps et la génitalité des femmes sont investigués et inscrits très tôt dans un contrôle médical.
Au XIXe siècle, les ouvrages médicaux recommandaient aux femmes ménopausées l'abstinence sexuelle. Aujourd'hui, il est déconseillé aux femmes de faire des enfants après 40 ans. Vous parlez, à côté de la ménopause physiologique, d'une « ménopause sociale ». De quoi s'agit-il ?
C. C. : J'ai essayé de montrer que ce n'est pas au moment de la ménopause physiologique que les femmes arrêtent de faire des enfants. La stérilité advient bien avant et cette stérilité sociale se construit dans le discours médical et médiatique. Les grossesses à partir de 38-40 ans sont présentées comme particulières : dans les ouvrages médicaux, on consacre des chapitres spécifiques à ces grossesses dites « dangereuses » ou « à risque », et à ce titre déconseillées. Dans les médias, elles sont affichées comme « tardives » et devant être justifiées. Ces discours construisent une norme de déprise de la fécondité à partir de la quarantaine. Par comparaison, les paternités après 40 ans ne sont pas pensées comme particulières. Dans les médias, quand une star masculine a un enfant à 60-70 ans, son âge n'est pas mis en avant.
Diriez-vous, à partir des entretiens que vous avez menés, que la norme de la ménopause s'impose davantage aux femmes issues des milieux urbains et/ou aisés ?
C. C. : Les manifestations corporelles ne provoquent pas que des effets en tant que telles, mais aussi dans l'interaction avec les autres. Les femmes des milieux urbains qui ont des postes d'encadrement ou en lien avec le public vont vivre les bouffées de chaleur sur le mode du « stigmate », parce qu'il y a une sorte d'irruption de ce qui est d'ordinaire caché : le corps, les rougeurs, la transpiration, l'odeur…, dans des lieux – la ville, les transports, le bureau –, où ces manifestations n'ont pas leur place et viennent mettre à mal l'image de soi. Pour « garder la face », selon l'expression d'Erving Goffman, ce type d'enquêtées va davantage avoir recours à des traitements hormonaux pour relégitimer le corps lorsque des rapports de pouvoir sont en jeu.



Vous revenez souvent dans votre livre sur le théâtre, la mise en scène de la ménopause. Le traitement médiatique sur le sujet est assez pléthorique (sites internet de santé, magazines, émissions, etc.) et connaît une large audience. Pouvez-vous nous résumer la pièce ?
C. C. : Les discours des médias sur la ménopause se font tous un peu écho : ils mettent en scène une femme, qui serait l'héroïne de la pièce Ménopause, avec un premier acte centré sur le « chaos » de la pré-ménopause. Les hormones y sont présentées comme des entités agissantes dont les femmes seraient les objets, venant déséquilibrer les corps et le psychisme.
Le deuxième acte est une sorte de caisse de résonance des discours médicaux sur les symptômes, qui sont décrits en termes dramatiques et très englobants : cela va de la sécheresse vaginale à la peau qui tiraille ou aux difficultés à se coiffer, en passant par la dépression et les problèmes de libido. Ce tableau apocalyptique se résout au troisième acte par une injonction à reprendre l'ascendant sur ce corps qui déraille, via des pratiques médicamenteuses, nutritionnelles, sportives ou sexuelles. C'est un régime d'action pour femmes ménopausées qui renvoie à un régime de performance lié aux représentations actuelles des seniors, enjoints au dynamisme, à l'action sur soi, à l'activité sociale, etc.
Vous avez constaté qu'en dehors du registre médical, il n'y a que le mode humoristique qui soit acceptable dans les discours sur la ménopause, avec le mode injurieux...
C. C. : En recensant pendant plusieurs années les discours sur la ménopause, j'ai remarqué que le seul registre acceptable pour en parler était le registre médical, avec des praticiens de santé. En dehors de ce cadre, dans la vie courante ou les médias, il n'y a que deux autres registres. C'est d'abord l'humour, un registre qui permet d'évoquer des choses blessantes ou de faire passer un message sous couvert du rire, comme l'a analysé Jean Duvignaud. L'autre registre, mis en avant par les enquêtées, est l'injure – « espèce de ménopausée ! » –, entendue ou subie. Cela dit quelque chose des représentations et de la charge de violence qui peut être associée au terme même de ménopause.
Que pensez-vous de l'émergence récente du concept d'andropause ?
C. C. : C'est une catégorie très intéressante à observer mais qui a du mal à s'imposer. De manière générale, le corps masculin et ses questions de génitalité ou de contraception sont beaucoup moins mobilisés par la recherche. Le corps féminin est toujours le plus investigué, le plus exposé et le plus surveillé. Je pense qu'il y aurait un travail à faire sur l'émergence de cette catégorie dans la littérature médicale et institutionnelle, et plus largement, sur les manières de penser la fécondité masculine. ♦
À lire
Cécile Charlap, La Fabrique de la ménopause, CNRS Éditions, février 2019, 272 p.
- 1. Cécile Charlap est maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse Jean-Jaurès et chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires - LISST (unité CNRS/Univ. Toulouse Jean-Jaurès/EHESS/École nationale de formation agronomique).
- 2. L’étude américaine Women’s Health Initiative (WHI), parue dans Journal of the American Medical Association, 2002, 288(3):321-33) et l’étude britannique Million Women Study (MWS) publiée en 2003 dans Lancet 362(9382):419-27.