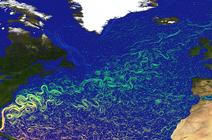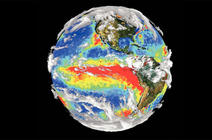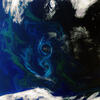Vous êtes ici
Pergélisol, le piège climatique

Les Inuits le savent bien, eux qui sont coutumiers des longues attentes dans les aéroports de la région. Voyager dans le Nord demande une bonne dose de patience. C’est à notre tour d’en faire l’expérience, en ce matin de décembre : le vol d’Air Inuit sur lequel nous avons embarqué à Montréal fait un atterrissage forcé à 150 kilomètres à peine de notre destination, Kuujjuarapik. Dans ce village inuit situé au sud de la baie d’Hudson, à l’embouchure de la rivière à la Baleine, le blizzard fait rage et empêche tout trafic aérien. Des conditions inhabituelles à cette époque de l’année. « À cause du changement climatique, la glace de mer tarde à se former sur la baie, ce qui crée une grande instabilité des masses d’air », nous explique-t-on.
Le plus gros réservoir de carbone continental
C’est loin d’être la seule conséquence des bouleversements climatiques dans le Nunavik, cette région arctique du Québec peuplée à 90 % d’Inuits. Ici, non seulement la banquise se réduit d’année en année, mais le pergélisol, le sol gelé en permanence, caractéristique des régions arctiques (permafrost, dans sa version anglo-saxonne), commence lui aussi à dégeler… Un vrai problème pour les infrastructures des quatorze municipalités de la région – routes d’accès et pistes d’aéroport défoncées, maisons qui voient le sol se déliter sous leurs fondations –, mais aussi pour le devenir climatique de la planète. C’est pour en savoir plus sur ce phénomène inquiétant que nous avons fait le voyage avec Florent Dominé : ce chercheur au laboratoire franco-canadien Takuvik a initié un vaste projet de recherche sur le pergélisol, le projet APT (Acceleration of Permafrost Thaw by Snow-Vegetation Interaction), réunissant pas moins de huit laboratoires français et canadiens1.

Le pergélisol représente 25 % des terres émergées dans l’hémisphère Nord, soit l’équivalent de la superficie du Canada. C’est le plus gros réservoir de carbone continental de la planète, devant les réserves de combustible fossile que sont le pétrole, le gaz et le charbon : « 1 700 milliards de tonnes de carbone d’origine végétale s’y sont accumulées depuis la dernière glaciation, explique Florent Dominé. C’est deux fois plus de carbone que n’en contient actuellement l’atmosphère ! » Problème, avec la hausse des températures atmosphériques, le pergélisol tend à se réchauffer, voire à dégeler par endroits – « au Nunavik, on a enregistré une hausse de 2 °C de la température du sol à 4 mètres de profondeur entre 1992 et 2010 », rappelle le Québécois Michel Allard, chercheur à Takuvik et partie prenante du projet APT. Or, en dégelant, le pergélisol libère dans l’atmosphère du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane, deux puissants gaz à effet de serre.
« Si la totalité du carbone emprisonné dans le pergélisol venait à être relâchée, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique », explique Florent Dominé, qui évoque une augmentation de 5 à 8 °C de la température d’ici à 2100, quand le pire scénario du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec)2 se situe aujourd’hui à 4 °C, faute de prendre encore en compte ces processus complexes, mis au jour récemment.
Trois sites sous haute surveillance
« Il est urgent d’intégrer le pergélisol aux modèles climatiques, martèle le chercheur. Pour ce faire, il faut connaître précisément l’évolution de son régime de température en fonction des conditions extérieures telles que la température de l’air, la vitesse du vent, la nature du sol, mais aussi, et on le sait moins, les caractéristiques du manteau neigeux qui le recouvre l’hiver… » Deuxième axe de recherche indissociable du premier : connaître et modéliser les processus de relargage des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. « Tout ce qu’on sait aujourd’hui, c’est qu’on est face à une redoutable boucle de rétroaction positive, poursuit le chercheur. Plus la température de l’air augmente, plus le pergélisol fond, plus la quantité de gaz à effet de serre augmente dans l’atmosphère, ce qui entraîne une nouvelle hausse de la température de l’air, et ainsi de suite… »

Trois sites ont été retenus pour mener cette étude de trois ans : l’île Bylot, le plus septentrional (73° de latitude nord), situé dans une région de pergélisol continu caractérisée par un paysage de toundra herbeuse ; Umiujaq (56° N), un village côtier situé dans une région de pergélisol discontinu présentant une alternance de forêt boréale et de toundra arbustive ; et enfin, Kuujjuarapik, le site le plus méridional (55° N), caractérisé par un paysage de pergélisol sporadique, qui fait la part belle à la forêt boréale et aux conifères – le but de notre voyage !
Le lendemain, le blizzard a fait place à un grand soleil. Nous survolons la baie d’Hudson à peine ridée par les premiers gels et plongeons vers Kuujjuarapik. Pas le temps de souffler au village : nous montons aussitôt dans l’hélicoptère qui doit nous emmener sur les buttes de pergélisol situées à quelques kilomètres de là. L’engin n’est pas une coquetterie : en Arctique, il n’y a tout simplement pas de routes ! Depuis le ciel, nous découvrons les palses, ces buttes de tourbe gonflées par la glace, et les mares créées par la fonte du pergélisol, aussi appelées mares de thermokarst, alignées comme autant de pots de peinture blanche. Les buttes sont en réalité les derniers reliquats du pergélisol qui existait autrefois à Kuujjuarapik, et dont 90 % a fondu ces dernières décennies. Nous nous posons sur l’une d’elles et déchargeons le matériel. Le thermomètre confirme que nous ne sommes pas là pour nous amuser : il fait – 23 °C ! Le temps de préparer les instruments, les appareils photo et les smartphones se figent : « problème de refroidissement », affiche un téléphone auquel le froid a fait visiblement perdre la tête.

Des hauteurs de neige trop importantes
Chaudement emmitouflé dans sa veste en duvet d’oie, bonnet vissé sur la tête, Florent Dominé est, lui, dans son élément. « La neige est un très bon isolant, proche des performances du polystyrène ou… d’une bonne doudoune, explique le chercheur. L’hiver, elle fait tampon entre le pergélisol et l’air extérieur et empêche le sol de se refroidir autant que ce dernier. Ses propriétés isolantes varient néanmoins en fonction de son épaisseur, de sa densité et de sa structure. Une couche de neige très épaisse sera plus isolante qu’une couche plus fine ; une neige peu dense préservera plus du froid qu’une neige plus compacte. » Le chercheur dégaine sa sonde à neige – il mesure 12 centimètres à peine d’épaisseur au sommet de la palse –, et enfonce une sonde de température dans la neige. À l’interface pergélisol-neige, la température atteint – 9 °C, soit 15 °C de plus que la température atmosphérique ! Grâce à une petite pelle de contenance connue (100 cm3), il ramasse la poudre blanche et la pèse sur la balance extraite de ses valises à instruments. De tête, il calcule sa densité. « Elle est encore assez légère », commente le chercheur. Nouvelle démonstration au pied de la palse, où la neige, nettement plus épaisse, s’est accumulée sur 80 centimètres de hauteur. La température du pergélisol au contact avec la neige y est de – 1 °C, proche du dégel !
La démonstration n’est pas innocente : avec le changement climatique, on enregistre non seulement une hausse de la température de l’air, mais également une augmentation du régime des précipitations (pluie et neige), du fait d’une plus grande évaporation. « C’est contre-intuitif, car tout le monde en Arctique peut constater que le nombre de jours de neige a diminué, explique le chercheur. Pourtant, lorsque la neige tombe, c’est en quantité bien plus importante qu’avant. Les hauteurs de neige tendent donc à augmenter, ce qui a un effet direct sur le réchauffement du pergélisol. ».
Autre facteur à prendre en compte pour une meilleure compréhension des effets du manteau neigeux : la végétation. Avec la hausse des températures atmosphériques, la couverture végétale s’accroît, tandis que les arbres et les arbustes migrent vers le nord. Or plus de végétation signifie des hauteurs de neige plus importantes. « La neige soufflée par le vent a tendance à s’accumuler en présence de végétation, au pied des arbres notamment », explique Florent Dominé. En outre, la végétation, de couleur sombre, diminue le pouvoir réfléchissant de la neige (celle-ci renvoie donc moins de chaleur et de rayonnement solaire vers l’espace) et modifie en profondeur ses propriétés optiques – autant de paramètres qui seront mesurés précisément dans le cadre du projet APT.

Le rôle décisif des mares de thermokarst
L’hélicoptère est de retour, prêt à nous ramener au village. La nuit ne va pas tarder à tomber et nous n’aurons malheureusement pas le temps de faire un arrêt près des mares de thermokarst. Déjà pris dans la glace à cette période de l’année, ces véritables bioréacteurs sont au cœur du processus de relargage du carbone gelé. Lorsque le pergélisol dégèle, des morceaux de sol se détachent et tombent dans l’eau, apportant nutriments et carbone aux bactéries et au plancton présents dans la mare, qui les dégradent en CO2 (dans les couches d’eau proches de la surface) et en méthane ou CH4 (dans le fond privé d’oxygène de la mare). « Des chercheurs ont analysé le méthane libéré par ces mares en plusieurs endroits de l'Arctique, rapporte Warwick Vincent, le directeur scientifique du Centre d’études nordiques, qui gère notamment les bases scientifiques de l’île Bylot, Umiujaq et Kuujjuarapik. Dans certaines, le carbone est âgé de plus de 20 000 ans ! Cela signifie que c’est le vieux carbone stocké dans le pergélisol qui est en train d’être relargué dans l’atmosphère. Pas vraiment une bonne nouvelle pour la planète… »
Le travail de modélisation des émissions gazeuses promet en tout cas d’être ardu. « Il existe des millions de ces mares en Arctique, sur une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés », estime Warwick Vincent. Le plus étonnant, c’est que ces mares de fonte n’ont pas toujours joué contre nous : dans les premiers milliers d’années qui ont suivi la fin de la dernière glaciation (il y a 15 000 ans), elles auraient contribué à réchauffer notre atmosphère encore glaciale, avant de se combler progressivement.
De retour à Kuujjuarapik, où nous nous installons pour la nuit dans les bâtiments du Centre d’études nordiques, une nouvelle achève de nous glacer les os, déjà bien rafraîchis par un après-midi sur la neige : un ours polaire a été aperçu en plein village, la nuit précédente, et les enfants sont privés de sortie jusqu’à nouvel ordre… « Quand j’étais enfant, dans les années 1950, des choses pareilles ne se produisaient pas », nous affirme Alec Tuckatuck, un chasseur inuit rencontré au Centre. C’est une conséquence de plus du changement climatique sur les régions arctiques : du fait de la diminution et de la fragilisation de la banquise, son habitat naturel, le géant blanc se met en effet à longer les côtes et entre dans les villages pour chercher de la nourriture… Le lendemain, le blizzard blanchit à nouveau le village. Il nous faudra patienter pour rentrer à Montréal. L’ours blanc, lui, a été abattu par les chasseurs.
Voir aussi
Auteur
Journaliste scientifique, Laure Cailloce est rédactrice en chef adjointe de CNRS Le Journal et de la revue Carnets de science.